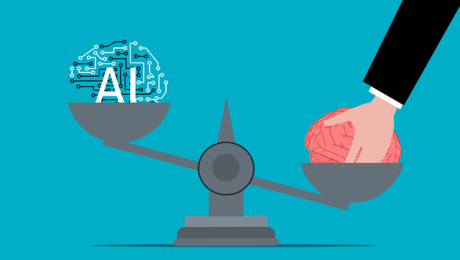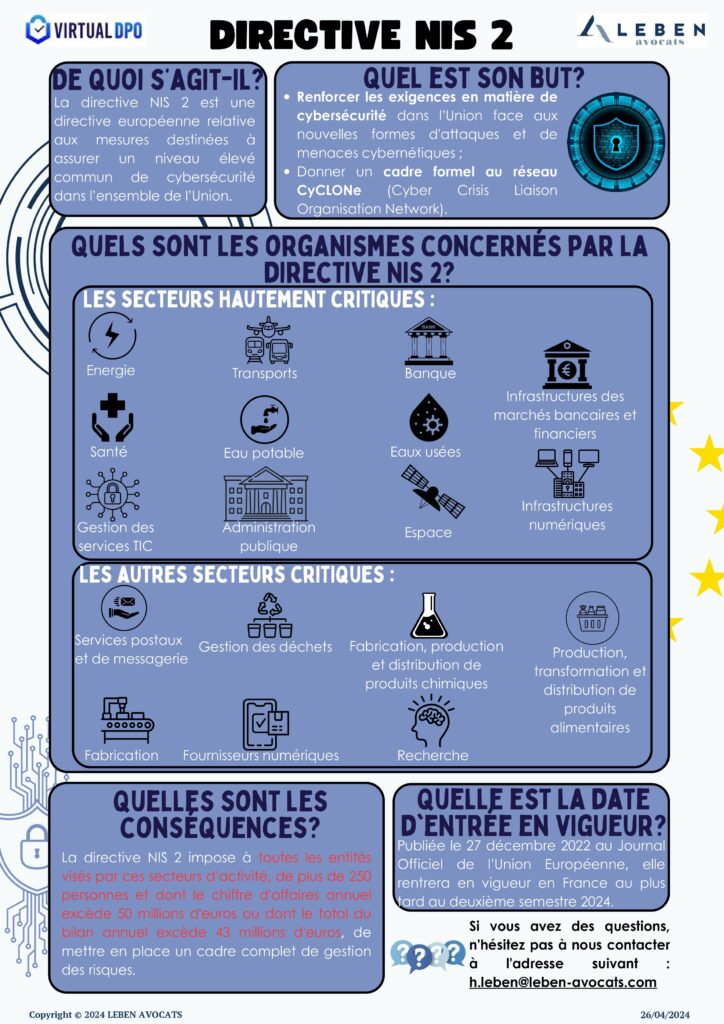IA Act :Nouvelles obligations dès août 2025
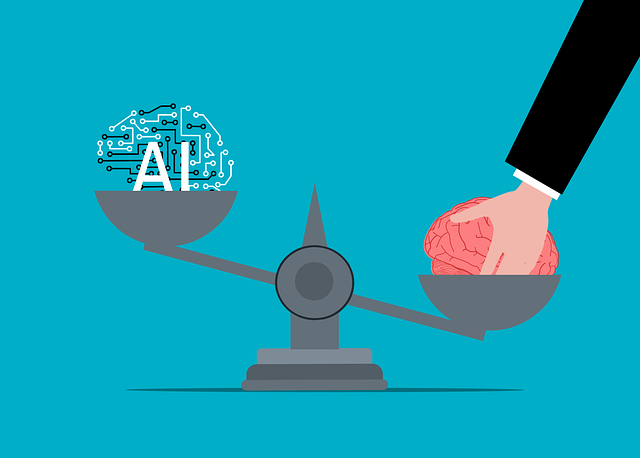
Adopté en mai 2024, l’IA Act constitue le premier cadre juridique mondial dédié à la régulation des systèmes d’intelligence artificielle. Son entrée en vigueur le 1er août 2024, a ouvert un calendrier d’application progressif visant à laisser aux acteurs le temps de s’y conformer.
La prochaine échéance clé est fixée au 2 août 2025 : une date qui marque l’entrée en application d’un ensemble de dispositions structurantes pour les opérateurs d’IA dans l’UE.
Quels sont les acteurs concernés ?
Les nouvelles obligations visent principalement :
- Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général (General Purpose AI – GPAI), c’est-à-dire les concepteurs et développeurs de systèmes d’IA pouvant être utilisés dans des contextes multiples et variés. Une IA à usage général désigne un système d’intelligence artificielle capable de remplir une large gamme de tâches, sans être limité à un usage spécifique ou à un domaine particulier.
- Les fournisseurs de GPAI à impact systémique : ce sont les acteurs exploitant des modèles présentant une large diffusion et une influence significative sur le marché européen ou la société, avec des exigences renforcées à leur charge.
- Les États membres de l’UE, qui doivent, à cette date, avoir désigné leurs autorités nationales compétentes chargées de la surveillance et de l’application du règlement.
Quelles sont les obligations à mettre en œuvre pour le 2 août 2025 ?
Pour les fournisseurs de GPAI : obligations de transparence et de documentation
Les développeurs de GPAI devront :
- Préparer et mettre à disposition une documentation technique détaillée permettant aux utilisateurs et aux autorités compétentes (qui seront désignées à la même date) de comprendre le fonctionnement du modèle. Cette documentation inclut notamment le processus d’entrainement et d’essai ainsi que les résultats de son évaluation et d’autre part, mettre à disposition des informations et de la documentation aux fournisseurs de systèmes d’IA qui envisagent d’intégrer le modèle permettant ainsi à ces derniers de comprendre ses capacités et ses limites.
- Publier un résumé synthétique des ensembles de données utilisées pour l’entraînement du modèle, en particulier les contenus protégés par le droit d’auteur, afin de renforcer la transparence sur les sources et de garantir le respect du droit de l’Union européenne. Ils sont également tenus de mettre en place une politique interne de conformité de droits d’auteur.
- Permettre aux titulaires de droits de vérifier le respect des conditions d’accès et d’utilisation de leurs œuvres, et, le cas échéant, de s’opposer à la fouille de données (“opt-out”). Cette transparence sur les sources devrait, en principe, permettre aux titulaires de droits d’auteur et de droits voisins de vérifier que les conditions d’accès et d’utilisation de leurs œuvres ont été respectées.
- Fournir une notice d’usage accessible, précisant les fonctionnalités du modèle, ses limites, les risques potentiels et les bonnes pratiques d’utilisation recommandées.
Pour les GPAI à impact systémique : exigences supplémentaires
Les fournisseurs de modèles considérés comme systémiques devront en plus mettre en place :
- une évaluation de risque ex-ante approfondies : procéder à des évaluations de risques préalables détaillées, non seulement sur les aspects techniques du modèle, mais aussi sur ses usages potentiels et ses effets sociétaux. Ces évaluations doivent être documentées, mises à jour régulièrement et intégrer des scénarios d’utilisation réels ou potentiels, afin d’identifier et de limiter les impacts négatifs avant la mise sur le marché ou la diffusion du modèle.
- des mesures de sécurité renforcées : démontrer la mise en place de mesures de sécurité adaptées pour prévenir les détournements ou les utilisations malveillantes du modèle. Les fournisseurs doivent également garantir la robustesse du modèle face à des usages non prévus et prévoir des dispositifs de détection et de réponse aux incidents de sécurité.
- une coopération active avec les autorités de supervision : les fournisseurs devront coopérer activement avec les autorités de supervision européennes et nationales, notamment en fournissant toutes les informations demandées sur leur modèle, ses risques, ses évaluations et les mesures de sécurité mises en place. Une transparence accrue et une communication régulière avec les régulateurs sont attendues pour garantir la conformité continue du modèle.
- Gouvernance robuste des données et des processus de développement : les fournisseurs devront instaurer une gouvernance stricte concernant la collecte, le traitement et l’utilisation des données d’entraînement, ainsi que sur l’ensemble du cycle de développement du modèle.
Pour les États membres : désignation des autorités compétentes
Chaque État membre devra, avant le 2 août 2025 :
- Désigner les autorités nationales compétentes chargées de contrôler l’application de l’IA Act. Ces autorités seront responsables de la surveillance du respect du règlement et de la coordination avec les autres instances européennes. Si plusieurs autorités compétentes sont désignées au sein d’un même État membre, l’une d’entre elles fera office de point de contact national, afin de faciliter les échanges avec la Commission européenne, les autorités homologues et le grand public. Les systèmes d’IA à haut risque déjà soumis à une régulation sectorielle resteront régulés par les autorités qui les contrôlent aujourd’hui (par exemple l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour les dispositifs médicaux).
- Mettre en place les structures de surveillance, de contrôle et de traitement des réclamations des utilisateurs. Ces structures devront être dotées de ressources suffisantes pour mener à bien leurs missions et assurer un suivi continu des incidents ou plaintes.
Quelles sont les sanctions ?
En cas de manquement aux obligations prévues par l’IA Act, des sanctions financières particulièrement dissuasives sont prévues. Les amendes peuvent atteindre jusqu’à 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires mondial annuel de l’entreprise, en fonction de la gravité de l’infraction.
Les sanctions varient selon la nature du manquement : les violations des interdictions strictes (comme la manipulation cognitive ou la notation sociale) entraînent les pénalités les plus lourdes, tandis que les infractions aux obligations de transparence ou de documentation peuvent être sanctionnées à hauteur de 7,5 millions d’euros ou 1,5 % du chiffre d’affaires annuel mondial.
Dès le 2 août 2025, date d’entrée en application des premières dispositions du règlement, ces sanctions pourront être appliquées aux manquements relatifs aux modèles d’IA à usage général, notamment en cas de non-respect des exigences de transparence, de publication des jeux de données, ou d’absence de politique de conformité au droit d’auteur. Les autorités nationales compétentes et l’Office européen de l’IA seront chargés de la mise en œuvre et du suivi de ces sanctions.
En définitif, cette échéance du 2 août 2025 constitue une étape clé dans la construction d’un cadre juridique harmonisé visant à assurer un développement responsable et éthique des systèmes d’IA dans l’Union européenne. Les acteurs concernés, devront se préparer activement pour répondre à ces exigences en matière de transparence, de sécurité et de gouvernance.
Vous souhaitez un accompagnement en matière d’IA? Contactez nos équipes!
- Published in blog, Nouvelles technologies
L’intelligence artificielle (IA) face aux droits d’auteur : les premiers pas des juridictions américaines et européennes
District Court for the District of Delaware, 2 février 2025 N° 1 :20-cv-613-SB
Tribunal régional de Hambourg, jugement du 27.09.2024 – 310 O 227/23
La décision américaine : les contours du fair use et l’entraînement d’une IA
Récemment, la Cour de district du Delaware s’est prononcée sur l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur pour entraîner un modèle d’IA.
Dans cette affaire, la société Thomson Reuters, détenteur de Westlaw, une des principales plateformes de recherche juridique, s’est opposée à la société Ross, qui développe également une plateforme de recherche juridique intégrant un moteur de recherche basé sur l’Intelligence Artificielle (IA).
Pour perfectionner son moteur de recherche, la société Ross a entraîné son IA à partir du contenu éditorial et des annotations de Westlaw. Thomson Reuters considère que l’utilisation par Ross de son contenu pour entrainer son IA constitue une contrefaçon de ses droits d’auteur. En défense, Ross soulève l’exception américaine de « fair use ».
Pour rappel, le « fair use » est une exception américaine au droit d’auteur qui évalue, selon 4 critères, si l’usage par un tiers d’une œuvre protégée peut être considérée comme « loyal » et « raisonnable ».
En vertu de cette exception, l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur ne peut être interdite.
Cette règle implique la mise en balance des intérêts de l’auteur à ce que son œuvre soit protégée et celui des tiers à ce que l’œuvre puisse servir de base à la création d’un autre objet.
Les 4 critères sont les suivants :
- Le but et la nature de l’usage
- La nature de l’œuvre protégée
- L’étendue de l’utilisation de l’œuvre protégée et dans quelle mesure cette utilisation représente une part importante de l’ensemble de l’œuvre protégée par le droit d’auteur ;
- Les conséquences de cet usage sur le marché.
Ces critères sont appréciés in concreto par le juge.
Dans cette affaire, c’est sur le fondement notamment des 1er et le 4e critères que la cour américaine s’est prononcée en faveur de la protection des droits de l’auteur.
En effet il n’était pas contesté que l’objectif de Ross en utilisant le contenu de Thomson Reuters, était de créer un outil de recherche juridique concurrent. En conséquence, l’impact sur le marché de la recherche juridique aurait été la naissance d’un nouveau concurrent, à laquelle Westlaw aurait involontairement participé !
Après analyse de ces critères, et estimant que « le second facteur importe moins que les autres, et le quatrième plus » (traduction libre), le juge considère que l’usage par Ross du contenu protégé de la plateforme n’est pas loyal. En conséquence, il ne retient pas l’exception de fair use soulevée par Ross.
Cette décision nous en apprend plus sur la manière dont l’utilisation de l’IA est encadrée par le droit états-unien.
Dans cette affaire, l’IA est regardée comme le serait n’importe quel autre moyen permettant la contrefaçon. Le juge ne tire aucune conséquence du fait que le moteur de recherche de Ross se base sur l’IA. Il statue uniquement sur l’existence ou non de la contrefaçon résultant de l’entraînement de cette IA sur des contenus protégés par le droit d’auteur.
Par conséquent, même si la cour prononce un jugement en défaveur de l’utilisateur d’IA, elle n’interdit pas sa pratique tant qu’elle est conforme à la l’exception de fair use.
Cette récente décision devrait s’appliquer également dans les pays du Common law qui utilisent la doctrine très similaire du « fair dealing ».
Elle se rapproche également de notre propre appréhension de l’IA dans le cadre du droit d’auteur en Europe via l’exception de « fouille de textes et de données ».
Le point de vue européen : l’exception de fouille de textes et de données
La fouille de textes et de données, ou datamining, est une exception aux droits d’auteur définie par l’article L122-5-3 I) du Code de la propriété intellectuelle comme « la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations ».
En d’autres termes, c’est le procédé technique et automatisé par lequel les IA analysent de grandes quantités de données pour parfaire leurs connaissances et leurs capacités. Sous certaines conditions, cette fouille de textes et de données peut s’affranchir du monopole de droit d’auteur.
C’est la Directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique qui a introduit ces exceptions au droit d’auteur dans deux articles :
- L’article 4 qui instaure une exception générale : il permet la fouille de textes et de données en permettant cependant aux auteurs de s’y opposer, en l’exprimant expressément en amont (opt-out).
- L’article 3 qui pose une exception spécifique : il autorise la fouille de données sur des œuvres protégées par le droit d’auteur accessibles de manière licite, si cet usage est effectué par des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel à des fins de recherche scientifique et à but non lucratif.
Ces articles sont d’ailleurs respectivement transposés en droit français aux articles L122-5-3 III) et L122-5-3 II) du Code de la propriété intellectuelle.
Le Tribunal régional d’Hambourg a récemment eu l’occasion de statuer sur la base de cette directive.
Le tribunal a en effet rendu le 27 septembre 2024 la première décision mettant en application les articles 3 et 4 de la directive de 2019, tels que transposés en droit allemand.
Dans cette affaire, les juges ont élargi la portée de l’article 3 de la directive concernant l’exception à des fins de recherches scientifiques.
Ils ont considéré qu’un photographe ne pouvait pas s’opposer à l’intégration de ses photos dans une base de données pouvant être utilisée pour entraîner des IA génératives, car si la constitution d’une telle base de données n’était pas directement affiliée à la recherche scientifique, son accès libre et gratuit, donc sans objectif commercial, pouvait permettre à des scientifiques de l’utiliser, lui donnant ainsi indirectement une valeur scientifique.
Finalement, que ce soit via la règle du fair use pratiquée aux Etats unis ou au travers de l’exception de fouille de textes et de données dans l’Union Européenne, l’on retiendra que :
- L’entraînement d’IA à partir d’œuvres protégées est un procédé qui n’est pas interdit par principe ;
- L’usage est admis et facilité dans le cadre d’objectifs non lucratifs et de recherche scientifique ;
- En revanche, l’exploitation commerciale, sans autorisation, constitue un acte de contrefaçon exposant son auteur à des sanctions.
District Court for the District of Delaware, 2 février 2025 N° 1 :20-cv-613-SB
Tribunal régional de Hambourg, jugement du 27.09.2024 – 310 O 227/23
Pour toute question ou demande, vous pouvez contacter nous ici.
- Published in blog, Propriété intellectuelle
Obligation d’information et de conseil : une responsabilité clé pour les prestataires informatiques en matière de cybersécurité – Cour d’appel de Rennes,19 novembre 2024
Dans un contexte où la menace cyber est une réalité incontournable pour les entreprises, la Cour d’appel de Rennes a appliqué avec fermeté les exigences en matière d’information et de conseil qui pèsent sur les prestataires informatiques en matière de cybersécurité.
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence constante suivant laquelle le prestataire informatique ne saurait se contenter d’exécuter à la lettre les demandes de son client, sans exercer pleinement son devoir de conseil et d’accompagnement.
Les faits : un renouvellement d’infrastructure aux conséquences lourdes
Une entreprise avait sollicité un prestataire spécialisé en cybersécurité pour moderniser son infrastructure informatique.
Le contrat prévoyait l’installation du matériel informatique en quatre phases.
Le matériel a été livré et installé par le prestataire en novembre 2019.
Quelques mois plus tard, en juin 2020, l’entreprise a été victime d’une cyberattaque par rançongiciel.
L’ensemble de son système d’information ayant été chiffré par les responsables de l’attaque, l’activité de l’entreprise a été intégralement à l’arrêt pendant une semaine, puis a repris progressivement.
L’attaque a généré des coûts importants pour la récupération et la réorganisation des données du client (intervention de prestataires extérieurs, mobilisation de ses salariés).
Deux rapports réalisés par deux prestataires intervenus en réponse à l’incident, ont mis en lumière les constats suivants :
- une absence de mécanisme de sauvegardes déconnectées du réseau de production ;
- une mauvaise configuration du contrôleur de domaine ;
- une multitude de comptes a forts privilèges sans besoin apparent ;
- des paramétrages non compatibles avec les exigences de sécurité.
L’entreprise a donc assigné le prestataire informatique aux fins de le voir condamné à lui indemniser la somme de 482.463,03 euros au titre de son préjudice, en raison des manquements à son obligation d’information, de conseil et de délivrance.
En première instance, le tribunal rejette l’ensemble des demandes, au motif que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le prestataire aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Le jugement est cassé par les juges de la Cour d’appel de Rennes.
La décision de la Cour d’appel de Rennes
Le prestataire soutient que le contrat ne consistait qu’en la fourniture de matériels et de logiciels pour remplacer les équivalents obsolètes et produit une note technique indiquant que la mission de sauvegarde des données ne relevait pas de la mission contractuellement dévolue au prestataire.
Cependant, la cour juge qu’ « en matière de prestations informatiques comprenant l’installation d’une nouvelle architecture, considérées comme un produit complexe, le fournisseur a l’obligation de s’assurer que ses prestations répondent aux besoins de son client, qu’il aura analysés » et ajoute que « pour y parvenir il doit s’informer sur ses besoins pour lui présenter une proposition commerciale adaptée ».
La cour relève tout d’abord que l’entreprise cliente n’était pas un professionnel de l’informatique.
Elle relève en outre, dans les conditions générales du prestataire, que celui-ci s’engageait « à mettre en œuvre les mesures de sécurité techniques et d’organisation de systèmes de services se conformant aux normes standards et aux usages internationaux applicables dans son secteur d’activités, notamment afin d’empêcher l’accès accidentel ou non autorisé aux infrastructures et données supportant l’application et/ou la solution logicielle et/ou le site internet objet(s) du Contrat ».
Ainsi, si le prestataire, pour se dispenser de son obligation d’information et de conseil en matière de sécurité, a soutenu que l’entreprise cliente disposait d’un service informatique composé de trois personnes, la cour estime que ces dernières « ne peuvent se voir attribuer les mêmes compétences expertales que celles qui sont revendiquées par [le prestataire] qui s’affiche spécialiste en matière de cybersécurité. »
La cour constate qu’ « à aucun moment [le prestataire] ne démontre qu'[il] a informé sa cliente de ce risque et donc qu'[il] a respecté son devoir de mise en garde alors que sa proposition commerciale prévoyait l’accompagnement au changement pour les utilisateurs. »
Elle conclut donc que :
- si la demande de l’entreprise cliente n’était pas assez précise, le prestataire aurait dû solliciter sa cliente pour faire préciser sa commande ;
- au besoin, il devait la conseiller sur l’architecture nécessaire à la sécurisation de ses données et lui signaler que ses travaux ne comportaient pas l’installation de sauvegardes déconnectées.
Un devoir d’expertise proactive
Autrement dit, le simple respect des besoins exprimés par le client et/ou du cahier des charges ne suffit pas à dégager le prestataire de sa responsabilité.
En tant qu’expert informatique, il doit être proactif, formuler des recommandations éclairées et s’assurer que la solution proposée est réellement adaptée, même si cela implique de remettre en question les demandes initiales du client.
En matière de cyberattaques : l’indemnisation de la perte de chance
Bien entendu, les juges rappellent que le prestataire n’est pas responsable de la cyberattaque elle-même.
Toutefois, le manquement à ses obligations contractuelles a privé la cliente de la possibilité de limiter les conséquences de l’attaque ou de mieux y résister.
La cour d’appel condamne donc le prestataire à indemniser son client du préjudice fondé sur la perte de chance (soit à la somme de 50 000 euros en l’espèce).
Une jurisprudence constante
La décision de la Cour d’appel de Rennes s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui impose un devoir de conseil au fournisseur d’un produit complexe en matière informatique :
Conseils pratiques pour les entreprises et leurs partenaires
Cette affaire rappelle aux entreprises comme à leurs prestataires quelques principes clés :
- Pour les prestataires informatiques
- Être proactif dans l’analyse des besoins réels des clients.
- Fournir et documenter des préconisations détaillées, y compris en matière de risques, coûts et alternatives techniques.
- S’assurer que le client est accompagné dans la maîtrise opérationnelle de la solution installée.
- Pour les clients
- Formaliser dans les contrats les obligations précises du prestataire : information, conseil, suivi.
- Former les équipes aux pratiques de cybersécurité, car aucun système technique n’offre une sécurité absolue.
En somme, cette décision confirme que le contrat ne se limite pas à la simple livraison et installation de matériel informatique : le prestataire informatique est attendu sur sa capacité à guider, alerter et accompagner son client, y compris au-delà de la lettre du cahier des charges.
Cour d’appel de Rennes, 19 novembre 2024
Pour toute question ou demande, vous pouvez contacter nous ici.
- Published in blog, Nouvelles technologies
La délicate balance des intérêts entre les droits des personnes au respect de leur vie privée et la liberté d’expression et d’information
Le 20 février 2025, la Cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10) a rendu un arrêt intéressant concernant le droit à l’oubli et la liberté d’expression. Cette décision met en lumière les tensions entre la protection des données personnelles et le droit du public à l’information.
I. Résumé de la décision
M.X, ancien président de la section football du Racing Club de France au cours des années 2002 et 2004, avait été condamné en 2009 par le tribunal correctionnel de Nanterre, à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros pour complicité d’abus de confiance et recel de biens obtenus à l’aide d’un abus de confiance, ainsi que pour abus de biens sociaux.
Les faits reprochés portaient sur des détournements de subventions destinées à une association, utilisées pour la gestion du club et le paiement de joueurs.
A la suite de l’appel de ce jugement, la cour d’appel de Versailles, en 2011, avait partiellement infirmé le jugement, réduisant la peine d’emprisonnement avec sursis à un an et augmentant l’amende à 30 000 euros, tout en ordonnant l’exclusion de cette condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X.
Entre ces deux décisions, le 15 juin 2009, le journal 20 Minutes avait publié un article intitulé « Il détournait de l’argent pour un club », relatant cette affaire.
Dix ans après, en 2019, M. X. avait demandé à 20 Minutes de supprimer ou d’anonymiser l’article en question, invoquant le droit à l’oubli prévu par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Le journal avait mis à jour l’article en mentionnant l’appel, mais avait refusé de le supprimer ou de l’anonymiser. M. X. avait alors assigné 20 Minutes en justice, demandant la suppression de l’article ou, à défaut, l’anonymisation de son nom.
Dans l’instance relative à la suppression de l’article de 20 Minutes, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de M.X, estimant que l’article contribuait à un débat d’intérêt général et que le maintien en ligne de l’article, même ancien, était justifié. M. X. a donc interjeté appel de cette décision.
En appel, la cour rappelle tout d’abord que « si le droit à l’effacement comme le droit d’opposition ne s’appliquent pas si le maintien des données est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ou s’il est motivé par des motifs légitimes et impérieux, il convient d’apprécier avant tout en l’espèce si les données d’identification de la personne et la mention de sa condamnation pénale doivent être considérées comme nécessaires à la liberté d’expression. »
Sur le fondement des articles 17 (droit à l’effacement) et 21 (droit d’opposition) du RGPD, la cour d’appel de Paris confirme le jugement, considérant que :
- L’article de 20 Minutes relatait des faits avérés et portait sur un sujet d’intérêt général d’actualité, justifiant ainsi sa diffusion ;
- La mise à jour de l’article en 2019, mentionnant l’appel, était suffisante pour informer les lecteurs de l’évolution de l’affaire ;
- Le droit à la protection des données personnelles ne saurait être interprété comme un droit à faire disparaître des contenus médiatiques publiés sur internet, indépendamment d’un abus de la liberté d’expression.
II. Analyse de l’arrêt d’appel
Cette décision illustre l’équilibre délicat entre le droit à l’oubli et la liberté d’expression. Elle rappelle la double limite, (i) à la fois des droits de personnes concernées au titre du RGPD, (ii) et des droits des organes de presse dans l’exercice de la liberté d’expression.
(i) Le RGPD reconnaît le droit des individus à obtenir l’effacement de données personnelles les concernant et/ou de s’opposer à un traitement. Cependant, ce droit n’est pas absolu et doit être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, tels que la liberté d’expression et le droit du public à l’information.
Au visa des articles 17 et 21 du RGPD, les juridictions procèdent alors à une analyse in concreto de la notion de nécessité du maintien de l’information dans le cadre de la liberté d’expression.
A ce titre, la cour relève que l’article de 20 Minutes, bien que relatif à des faits anciens, conserve un intérêt public. En effet, elle relève que l’information s’inscrit dans le sujet toujours actuel des relations entre le sport et l’argent, notamment de la gestion des fonds publics dans le milieu sportif.
Elle ajoute que M. X. reste une personnalité publique en raison de ses fonctions passées et présentes, M. X. étant resté dirigeant dans le domaine sportif (président de la fédération française des sports de combat, président de la fédération des sports de combat au Luxembourg) et une personnalité du monde politico-médiatique.
Sur la demande d’anonymisation de l’article, la cour considère qu’en l’espèce, le nom est un élément essentiel de l’information et que restreindre son accès, constitue une restriction excessive à la liberté de la presse.
De plus, la mise à jour de l’article pour refléter l’évolution de la procédure judiciaire a été jugée suffisante pour assurer une information complète et précise du public, nonobstant le fait :
- qu’il existe une erreur sur les sommes détournées, la différence ne suffisant pas, selon la cour, à considérer que l’information était fausse ;
- que la mention de l’appel de la décision du tribunal correctionnel de Nanterre n’est pas assez directe, cela ne rendant pas non plus l’information inexacte.
Elle rappelle enfin que la dispense d’inscription de la condamnation au casier judiciaire B2, n’interdit pas la connaissance de l’information par le public.
En conséquence, les médias, en tant qu’acteurs essentiels de la démocratie, ont la liberté d’informer le public sur des sujets d’intérêt général, y compris les condamnations pénales de personnalités publiques.
(ii) Cependant, cette liberté n’est pas sans limites. Les médias doivent veiller à la véracité des informations diffusées et à leur mise à jour en cas d’évolution significative, comme une décision judiciaire modifiant une condamnation. Dans cette affaire, la cour considère que 20 Minutes a respecté cette obligation en mentionnant l’appel et l’infirmation partielle de la peine.
Par ailleurs, la cour rappelle que la dérogation des organes de presse au regard du droit à l’oubli consacré tout d’abord, par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Google Spain (CJUE, arrêt du 13 mai 2014, Google Spain, C-131/12), puis par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Hurbain c. Belgique 4 juillet 2023) n’est pas non plus absolue.
Ainsi, pour les archives de presse, l’organe de presse est tenu de démontrer que la persistance de la publicité des données est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information et ne porte pas une atteinte exagérée au droit à l’oubli et au respect de la vie privée, en reprenant les critères dégagés par l’arrêt Hurbain c/ Belgique, à savoir :
- Le temps écoulé depuis les faits rapportés et l’intérêt contemporain de l’information ;
- La notoriété de la personne ;
- La nature de l’information archivée ;
- Les répercussions négatives de la persistance de l’information sur le site ;
- L’impact de la mesure sur la liberté d’expression et le degré d’accessibilité.
En conclusion, cette décision rappelle que la protection des données personnelles ne doit pas conduire à une réécriture de l’histoire ou à une censure injustifiée de l’information. Les médias ont la liberté d’informer le public sur des sujets d’intérêt général, même si cela implique la diffusion d’informations sensibles concernant des individus. Toutefois, ils doivent veiller à respecter les droits des personnes concernées, notamment en mettant à jour les informations publiées pour refléter fidèlement la réalité et en tenant compte du temps écoulé depuis les faits et de l’atteinte potentielle à la réputation de l’individu.
Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 février 2025
Pour toute question ou demande, vous pouvez nous contacter ici.
- Published in blog, Données personnelles
Revente de jeux vidéo dématérialisés : la Cour de cassation confirme la victoire de Steam

Arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 : la revente de jeux vidéo dématérialisés peut être interdite, c’est confirmé !
La Cour de cassation s’est prononcée le 23 octobre 2024 dans l’affaire opposant Valve (Steam) à l’association UFC QUE Choisir.
Cet arrêt fait suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 21 octobre 2022 : qui avait infirmé la décision rendue en première instance (tribunal de grande instance du 17 septembre 2019.
Pour rappel, la plateforme Steam propose un service de distribution en ligne de contenus numériques dont des jeux vidéo. Pour accéder à ces contenus l’utilisateur doit télécharger un logiciel et accepter les conditions de Valve, l’ « Accord de souscription Steam ».
En 2015, l’association UFC Que Choisir a assigné les sociétés Valve SARL et Valve corporation en constatation du caractère abusif ou illicite et en suppression de plusieurs clauses de l’accord de souscription. A ce titre, était notamment contestée la licéité de la clause d’interdiction de la revente des jeux vidéo dématérialisés.
En première instance, le tribunal judiciaire de Paris a sanctionné l’interdiction de la revente des jeux vidéo dématérialisés estimant que la règle de l’épuisement des droits prévue par la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 relative à la protection juridique des programmes d’ordinateur s’appliquait aux jeux vidéo dématérialisés. Cette décision s’inscrivait dans le sillage de la décision CJUE du 3 juillet 2012, UsedSoft, C-128/11 qui avait appliqué la règle de l’épuisement des droits aux copies matérielles et immatérielles d’un programme d’ordinateur. Cette solution pouvait en partie s’expliquer au regard de la similitude technique des jeux dématérialisés, c’est-à-dire de jeux entièrement composés de lignes de code, aux programmes d’ordinateur.
Pour rappel, la règle de l’épuisement des droits est un mécanisme prévoyant que le droit de distribution dans l’Union européenne ou l’EEE relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans l’UE ou l’EEE de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement. Ainsi, le titulaire du droit ne peut pas continuer à contrôler les ventes successives.
La règle de l’épuisement des droits est prévue par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 applicable au droit d’auteur et par la directive 2009/24 applicable aux programmes d’ordinateur.
Le tribunal judiciaire de Paris avait donc appliqué le régime applicable aux programmes d’ordinateur au jeu vidéo dématérialisé.
Ce n’est cependant pas la solution qu’ont retenue la Cour d’appel et la Cour de cassation.
En appel, les juges ont estimé que la directive n’était pas applicable à la revente de jeux vidéo dématérialisé dès lors que le jeu vidéo dématérialisé est constitué d’un ensemble de contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle qui ne se limite pas au simple programme d’ordinateur : en effet, un jeu vidéo est composé de programmes, de musique, de design etc. La Cour d’appel de Paris a écarté la règle de l’épuisement des droits à la revente de jeux vidéo dématérialisés, estimant notamment, d’un point de vue économique, que le préjudice lié à la revente de jeux vidéo dématérialisé pour les auteurs est plus conséquent que pour le marché d’occasion des programmes d’ordinateurs.
L’UFC Que Choisir a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt estimant notamment que « le logiciel d’un jeu vidéo n’est pas accessoire et relève, par sa nature, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, et non pas de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 ; qu’en outre, s’agissant du marché des copies de jeux vidéo, ou marché de l’occasion, il n’existe aucune différence selon que la copie est faite à partir d’un support matériel ou à partir d’internet ».
La Cour de cassation rejette ce moyen du pourvoi à l’aune de la jurisprudence de la CJUE interprétant les considérants de la directive 2001/29 (arrêts du 22 janvier 2015, Art & Allposters International, C-419/13 et du 19 décembre 2019, Tom Kabinet, C-263/18) suivant laquelle la directive ne laisse pas la possibilité aux Etats membres de prévoir une règle d’épuisement autre que celle énoncée par la directive et que cet épuisement s’applique à l’objet tangible dans lequel un œuvre protégée ou sa copie est incorporée c’est-à-dire qu’aux produits matériels.
Elle estime par ailleurs que la directive sur les programmes d’ordinateurs constitue un lex specialis dont le champ d’application doit être interprété de manière restrictive. Reprenant les motifs de la Cour d’appel suivant lesquels le jeu vidéo n’est pas un programme informatique à part entière mais un œuvre complexe et « que, à la différence d’un programme d’ordinateur destiné à être utilisé jusqu’à son obsolescence, le jeu vidéo se retrouve rapidement sur le marché une fois la partie terminée et peut, contrairement au logiciel, être encore utilisé par de nouveaux joueurs plusieurs années après sa création », elle écarte en conséquence l’application de la directive 2009/24 applicable aux programmes d’ordinateur.
Elle conclut que la Cour d’appel a déduit à bon droit que seule la directive 2001/29 est applicable aux jeux vidéo, que la règle de l’épuisement du droit ne s’applique pas en l’espèce.
La solution est évidemment une bonne nouvelle pour les éditeurs de jeux vidéo dès lors qu’ils peuvent interdire la revente des jeux vidéo dématérialisés et ainsi conserver un contrôle sur la chaîne de distribution.
Pour tout savoir sur Droit et Jeux vidéo
- Published in blog, Jeux vidéo
Documenter la conformité de ses sous-traitants et sous-traitants ultérieurs

Documenter la conformité de ses sous-traitants et sous-traitants ultérieurs, une nécessité : nouvel avis du CEPD
Le comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté, le 7 octobre 2024, à la demande de l’autorité de protection des données danoise, un avis sur certaines obligations découlant du recours au(x) sous-traitant(s) et au(x) sous-traitant(s) ultérieurs.
Dans cet avis, le CEPD limite son analyse aux obligations du responsable du traitement relatives à la conformité des sous-traitants et sous-traitants ultérieurs en vertu de l’article 28, paragraphes 1, 2 et 4 du RGPD et aux obligations d’accountability du responsable du traitement en vertu de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 24, paragraphe 1, du RGPD.
Si l’avis ne révolutionne pas l’interprétation du RGPD, il apporte toutefois un éclairage important sur l’étendue des obligations du responsable de traitement vis-à-vis de la chaîne de sous-traitance et risque de bousculer quelque peu la pratique.
En effet, l’on constate généralement que les responsables de traitement recensent l’ensemble des sous-traitants de rang 1 dans le registre des activités de traitement et disposent de la liste des sous-traitants ultérieurs (sous-traitant de rang 2), de façon disparate, dans les accords de sous-traitance signés avec leurs sous-traitants (si tant est qu’un DPA ait été signé, ou que l’annexe sur les sous-traitants ultérieurs ait été remplie, ce qui n’est pas toujours le cas).
De façon générale, il ressort de l’avis que :
- les responsables de traitement doivent mettre à disposition à tout moment l’identité de tous leurs sous-traitants, y compris celle de leurs sous-traitants ultérieurs et ce quel que soit le risque associé au traitement. Ces informations sont : le nom, l’adresse et la personne de contact (nom, fonction, coordonnées) du sous-traitant et la description du traitement (y compris une délimitation claire des responsabilités dans le cas où plusieurs sous-traitants sont autorisés) ;
- les sous-traitants doivent fournir les informations relatives aux sous-traitants ultérieurs au responsable de traitement et les tenir à jour. Ainsi, dans les cas où le responsable du traitement décide d’accepter certains sous-traitants secondaires au moment de la signature du contrat, une liste des sous-traitants secondaires agréés doit figurer dans le contrat ou dans une annexe à celui-ci. La liste doit ensuite être tenue à jour, conformément à l’autorisation générale ou spécifique donnée par le responsable du traitement (v. page 9 de l’avis).
Pour ceux qui n’auraient pas encore mis en place de tels processus, les responsables de traitement doivent donc réfléchir à une méthode pour centraliser, permettre la mise à jour et documenter la conformité de l’ensemble de leurs sous-traitants et sous-traitants ultérieurs. De plus, en cas de contrôle de la CNIL, cette documentation permettra à la société de justifier de sa conformité au RGPD et ainsi éviter des sanctions sur le fondement du principe d’accountability notamment.
L’avis du CEPD apporte par ailleurs des précisions quant aux obligations (A) de vérification et de documentation par le responsable de traitement du caractère suffisant des garanties fournies par tous les sous-traitants de la chaîne de traitement, (B) de vérification du contrat entre le sous-traitant initial et les sous-traitants ultérieurs et enfin (C) d’encadrement des transferts hors UE dans la chaîne de sous-traitance.
A. Vérification et documentation par le responsable de traitement du caractère suffisant des garanties fournies par tous les sous-traitants de la chaîne de traitement
L’obligation de s’assurer que les sous-traitants ultérieurs et toute la chaîne de sous-traitance présentent des garanties suffisantes, incombe au responsable de traitement (v. page 13 de l’avis).
Le CEPD rappelle que le recours à un sous-traitant ou à un sous-traitant ultérieur et tout autre sous-traitant de la chaîne ne doit pas conduire à abaisser le niveau de protection des données qui serait garanti si le traitement était réalisé directement par le responsable de traitement (v. page 13 de l’avis).
Il précise par ailleurs que cette obligation incombe au responsable de traitement pour le recours aux sous-traitants ET aux sous-traitants ultérieurs, estimant que le terme « sous-traitant » de l’article 4 RGPD s’applique au sous-traitant de premier rang mais également aux sous-traitants de second rang etc. (v. page 8 de l’avis).
En outre, l’obligation du responsable du traitement de vérifier si les sous-traitants présentent des garanties suffisantes pour mettre en œuvre les mesures déterminées par le responsable du traitement devrait s’appliquer quel que soit le risque pour les droits et libertés des personnes concernées.
Le responsable de traitement, suivant la nature, la portée, le contexte et les finalités du traitement ainsi que les risques pour les droits et libertés des personnes physique, procède à des vérifications plus ou moins approfondies : la certification et l’adhésion à un code de conduite par le sous-traitant sont des éléments permettant de démontrer l’existence de « garanties suffisantes » (v. page 15 de l’avis) ; suivant le niveau de risque, le responsable de traitement peut demander à son sous-traitant la communication des contrats signés ses sous-traitants ultérieurs afin de vérifier que les garanties y sont bien reportées.
La vérification des garanties suffisantes doit être effectuée à intervalle régulier au cours de la relation contractuelle avec les sous-traitants.
En conséquence, les accords de sous-traitance devraient prévoir les modalités et fréquence de la communication des informations relatives aux garanties suffisantes du sous-traitant et des sous-traitants ultérieurs.
En cas d’autorisation générale pour la sous-traitance ultérieure, le responsable de traitement doit communiquer au sous-traitant des directives relatives aux garanties suffisantes pour guider ses choix de sous-traitants ultérieurs (v. page 16 de l’avis).
Il est d’ailleurs intéressant de relever que le CEPD considère que la détermination des sous-traitants est considérée comme un « moyen essentiels » du traitement permettant de déterminer les qualifications de traitement (v. page 9 de l’avis). Ainsi, si le choix des sous-traitants ultérieurs relève uniquement du sous-traitant (ce qui est souvent le cas, surtout dans les contrats d’adhésion), ce critère permettrait de faire pencher la balance, entre autres, vers une qualification de responsable de traitement du prestataire. Les juristes savent cependant à quel point cette question est complexe.
B. Vérification du contrat entre le sous-traitant initial et les sous-traitants ultérieurs
Le sous-traitant initial est tenu de reporter les mêmes obligations en matière de protection des données dans les contrats de sous-traitance que celles qu’il conclut avec des sous-traitants ultérieurs.
Cette obligation est expressément prévue à l’article 28, paragraphe 4.
Le CEPD en déduit qu’à la demande du responsable du traitement, le sous-traitant initial devra ainsi fournir les contrats de sous-traitance entre le sous-traitant initial et les autres sous-traitants ultérieurs.
Une copie des contrats de sous-traitance ultérieure pourrait aider le responsable de traitement à démontrer que ses sous-traitants et sous-traitants ultérieurs présentent des garanties suffisantes, notamment que le sous-traitant se conforme à l’article 28, paragraphe 4, du RGPD.
La question se pose alors de savoir si les clauses de confidentialité incorporées aux contrats auxquels sont annexés les DPA pourront valablement permettre au sous-traitant de s’opposer à la communication des contrats avec les sous-traitants ultérieurs. En effet, il n’est pas rare que les sous-traitants soient réticents à communiquer la documentation contractuelle avec leur propre sous-traitant au responsable de traitement. La pratique conduira sûrement à caviarder certains éléments commerciaux ou stratégiques des contrats, sans rapport avec la conformité du prestataire au RGPD.
En termes de responsabilité, le CEPD précise que si un sous-traitant secondaire ne remplit pas ses obligations, la responsabilité finale de l’exécution des obligations de cet autre sous-traitant ultérieur incombe au responsable du traitement. Toutefois, le sous-traitant reste responsable vis-à-vis du responsable du traitement, de sorte que ce dernier a la possibilité d’introduire une action en garantie à l’encontre de son sous-traitant initial si ce dernier ne reporte pas les mêmes obligations de protection des données dans le cadre de la sous-traitance ultérieure.
C. Transferts hors UE dans la chaîne de sous-traitance
En cas de transfert hors UE s’effectuant entre deux sous-traitants et/ou sous-traitants ultérieurs sur instructions du responsable de traitement, le responsable de traitement doit s’assurer que le transfert s’effectue moyennant des garanties appropriées des articles 44 et suivants du RGPD et qu’il ne diminue pas le niveau de protection des données.
En cas de transfert, même s’il n’est pas effectué directement par le responsable du traitement, mais par un sous-traitant pour le compte du responsable du traitement, ce dernier reste soumis aux obligations découlant à la fois de l’article 44 du RGPD et de l’article 28, paragraphe 1, du RGPD.
L’obligation de l’article 44 incombe à la fois au responsable de traitement et au sous-traitant. Le responsable du traitement et le sous-traitant restent, en principe, responsables, en vertu du chapitre V du RGPD, d’un transfert initial ou ultérieur illicite et pourraient donc être tenus pour responsables, solidairement et individuellement, en cas de manquement.
En vertu de l’article 28, le responsable de traitement est tenu de vérifier que les transferts opérés dans la chaîne de sous-traitance sont conformes et ce, quel que soit le risque associé au traitement.
Le responsable de traitement doit pouvoir en justifier auprès des autorités de contrôle, notamment en produisant la documentation communiquée par son sous-traitant.
La documentation correspond à (i) la cartographie des transferts indiquant les données traitées, le lieu de transfert et les finalités, (ii) la base légale de transfert utilisée (décision d’adéquation, CCT, etc.) et, le cas échéant, l’ « évaluation de l’impact du transfert » et les mesures complémentaires. Ces informations doivent être communiquées au responsable de traitement avant que le transfert ne soit effectué.
Ainsi, il ne s’agit plus simplement de vérifier si le sous-traitant de premier rang est établi en dehors de l’Union européenne, fait partie d’un groupe international ou héberge ses serveurs en dehors de l’Union européenne. Le responsable de traitement doit vérifier si les sous-traitants ultérieurs auxquels il est fait appel sont eux-mêmes établis en dehors de l’Union européenne, font partie d’un groupe international ou hébergent leurs serveurs en dehors de l’Union européenne. Cette tâche peut s’avérer relativement chronophage, suivant la disponibilité des informations et le nombre de sous-traitants impliqués et poser des difficultés pratiques.
En conclusion, l’avis du CEPD réaffirme la conception originelle du RGPD suivant laquelle le responsable de traitement est responsable des traitements de données qu’il effectue et de ceux qui sont effectués par des tiers pour son propre compte.
Néanmoins, l’avis paraît largement inadapté à la vie des affaires et à la réalité.
Il suffit de se rappeler que parmi les sous-traitants ultérieurs on trouve en général un hébergeur (AWS, Google Drive, Azure..) ou des éditeurs de solutions on-line tels que Microsoft, Salesforce et autres GAFAM, pour comprendre que ni le responsable de traitement, ni son sous-traitant de rang 1, ne peuvent exercer de contrôle réel.
Il est donc probable que l’avis du CEPD ne viendra qu’apporter une pierre supplémentaire aux exigences d’accountability et à l’établissement d’une documentation toujours plus importante, sans pour autant garantir une meilleure protection des données personnelles. Reste qu’il ne s’agit à ce stade que d’un avis et qu’il reviendra à la CNIL de l’appliquer intégralement ou non.
Faites appel à un DPO externalisé
- Published in blog, Données personnelles
Comment utiliser des données accessibles sur Internet

Publier ou/et réutiliser des données librement accessibles en ligne : quelles règles s’appliquent en matière de protection des données à caractère personnel ?
La CNIL a publié le 12 juin 2024 sur son site internet des recommandations pour les diffuseurs publics et privés de données ouvertes ainsi que des recommandations pour les « réutilisateurs » de données publiées sur internet.
En effet, à chaque fois qu’un éditeur publie des données relatives à des personnes physiques sur son site internet (par exemple, un annuaire de professionnels) ou qu’une entreprise réutilise des données relatives à des individus librement accessibles en ligne (des chasseurs de têtes en recherche de profils sur Linkedin), les règles de protection des données à caractère personnel (i.e. le règlement (UE) 2016/679 (« RGPD ») et la loi n°78-17 (« Loi informatique et libertés »)) doivent être appliquées.
Ainsi, dans le but d’accompagner les diffuseurs et « réutilisateurs » dans leur mise en conformité au RGPD, la CNIL rappelle les principes gouvernant ces traitements, en les accompagnant de fiches méthodologiques et les illustrant de cas d’usage.
I. Les règles applicables aux diffuseurs de données ouvertes
Ces recommandations visent à encadrer les pratiques de mise à disposition du public de données personnelles. Elles s’adressent principalement aux administrations, entreprises, ou particuliers qui souhaitent diffuser des données accessibles en ligne.
Elles se déclinent en 6 fiches correspondant aux grands principes du RGPD.
- Fiche n°1 : qualification juridique des diffuseurs. Tout diffuseur de données personnelles doit au préalable s’interroger sur sa qualification au sens du RGPD, afin d’identifier ses obligations. La CNIL donne des exemples de responsabilités conjointes, distinctes et de sous-traitance. Elle fait un focus sur les licences de réutilisation de données et énonce que les diffuseurs de données peuvent choisir d’encadrer les réutilisations futures par le biais d’une licence. A ce titre, l’encadrement des finalités de réutilisation ne rend pas le diffuseur nécessairement responsable de traitement ou responsable conjoint, dès lors que le réutilisateur conserve un certain degré d’influence autonome sur ses traitements.
- Fiche n° 2 : base légale de son traitement. Les diffuseurs doivent s’assurer que la collecte et la mise à disposition des données reposent sur une base légale solide. Les bases légales envisageables pour la diffusion publique d’une base de données sont : i) l’obligation légale, ii) la mission d’intérêt public, iii) l’intérêt légitime, iv) le consentement. La CNIL propose une méthodologie permettant au diffuseur de données de choisir une base légale adaptée pour la diffusion des données au public.
- Fiche n°3 : information des personnes concernées. Les personnes doivent être informées de la diffusion de leurs données. L’information doit être complète, compréhensible et aisément accessible. La CNIL rappelle également les cas dans lesquels le diffuseur de données est dispensé de délivrer l’information aux personnes concernées, à savoir :
- lorsque la personne concernée a déjà obtenu les informations,
- lorsque les données n’ont pas été directement collectées auprès des personnes concernées et leur information se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés,
- ou lorsque le traitement est mis en œuvre aux fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire, ou d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste.
- Fiche n°4 : droits des personnes sur leurs données. Les personnes concernées doivent être en mesure d’exercer leurs droits. Les droits pouvant être exercés sont conditionnés suivant la base légale de traitement choisie (ex : si la base légale est le respect d’une obligation légale, le droit d’opposition ne peut être exercé, il pourra toutefois être exercé si le traitement repose sur l’intérêt légitime du diffuseur). La CNIL préconise par exemple de « permettre aux personnes concernées de s’opposer « d’emblée », au stade de leur information sur la mise en œuvre du traitement de diffusion, à certaines réutilisations de leurs données et communiquer sur ces oppositions auprès des éventuels réutilisateurs (p. ex. : publication d’un fichier d’opposition à la prospection commerciale, ou encore d’un « étiquetage » des informations en cause directement dans la base de données) ; et/ou de fournir, sur la plateforme de mise à disposition des données, un formulaire de contact, un numéro de téléphone et/ou une adresse de messagerie dédié(e) à l’exercice des droits ».
- Fiche n°5 : minimisation des données traitées. Les données diffusées doivent être pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour l’objectif visé. Le principe de minimisation interdit de conserver des données personnelles « au cas où elles seraient utiles ». Cependant, la CNIL précise que dans le cas de l’open data, il est possible de mettre à disposition, et donc de conserver, des données en vue d’une utilisation incertaine par des tiers réutilisateurs. Cela n’est bien entendu envisageable que si la mise en ligne de la base de données est elle-même légale, notamment parce qu’elle répond à une obligation légale ou ne porte pas aux droits des personnes une atteinte disproportionnée. Le diffuseur de données devra alors se demander si l’anonymisation des données est obligatoire ou si elle est envisageable (i.e. lorsqu’elle est techniquement possible et qu’elle ne contrevient pas aux objectifs du traitement), dans la négative, il devra vérifier s’il existe des dispositions légales qui encadrent le champ des données à diffuser et s’y conformer et, dans la négative, il devra alors sélectionner les données pertinentes et non excessives par rapport à l’objectif poursuivi.
- Fiche n°6 : exactitude, sécurité et conservation limitée des données. Les diffuseurs de données peuvent réaliser une analyse d’impact (AIPD) afin de s’assurer que la diffusion des données respecte tous les principes de protection des données. La CNIL énonce ensuite une liste des actions à mettre en œuvre afin de se conformer aux obligations d’exactitude et de sécurité des données. Elle préconise notamment que les diffuseurs prévoient dans leurs conditions de réutilisation des données un renvoi à ses recommandations pour les réutilisateurs de données publiées sur internet.
Il est à noter que le Data Governance act, entré en application depuis septembre 2023 vient compléter ces règles lorsque les données diffusées sont des informations publiques détenues par le secteur public.
II. Les règles applicables aux réutilisateurs de données publiées sur internet
La réutilisation des données publiées sur internet constitue une pratique courante des entreprises, soit à des fins internes, notamment pour se renseigner sur un candidat, un contractant, un élu etc., soit dans le cadre de leur activité client (représentation d’intérêt, chasseur de tête, etc.).
Ces recommandations se déclinent en 6 fiches principes (sur le même modèle que la diffusion des données) auxquelles s’ajoutent 3 fiches pratiques.
Les recommandations s’adressent aux « réutilisateurs de tous types de données personnelles publiées sur Internet – données mises à disposition à des fins de réutilisation (open data) et autres données librement accessibles en ligne (ex. : sites d’information et blogs, sites commerciaux, informations partagées par des internautes sur les réseaux sociaux, …) – par des personnes physiques ou morale, publiques ou privées, collectant les données en vue d’une exploitation de celles-ci pour leur propre compte ».
- Fiche n°1 : qualification juridique des réutilisateurs. Le réutilisateur doit s’interroger au préalable sur sa qualification RGPD afin de déterminer les obligations qui lui sont applicables. La CNIL précise que dans le cadre de contrats d’adhésion, « le fait de recourir à un logiciel de traitement de données personnelles conçu par un autre acteur, et sur lequel son utilisateur ne peut qu’effectuer certains paramétrages (voire aucun), ne dispense pas ce dernier de sa qualité de responsable de traitement, dès lors que c’est lui qui a décidé d’utiliser telles et telles données personnelles avec ce logiciel, pour une certaine finalité ». Ainsi, le réutilisateur demeurera responsable de traitement (seul ou conjointement) quand bien même l’outil utilisé pour la réutilisation desdites données ne peut être paramétré.
- Fiche n° 2 : base légale de son traitement. Les réutilisateurs doivent déterminer la base légale de leur traitement des données avant d’utiliser des données personnelles. La CNIL rappelle que les bases légales envisageables pour la réutilisation d’une base de données sont : i) l’obligation légale, ii) la mission d’intérêt public, iii) l’intérêt légitime, iv) le consentement et propose une méthodologie permettant au responsable de traitement de choisir une base légale adaptée pour la réutilisation des données. A titre illustratif, il est considéré que l’intérêt légitime pourrait valablement fonder la collecte par un employeur de données publiées sur un réseau social professionnel afin de contacter un candidat potentiel, dès lors que les personnes concernées, en les partageant sur un tel site s’attendent raisonnablement à ce type de réutilisations ou que l’intérêt légitime pourrait fonder la rediffusion, par des sociétés spécialisées dans l’information légale et financière, des données d’entreprises diffusées par les administrations chargées de leur mise à disposition au public (INPI et INSEE). A l’inverse, l’intérêt légitime ne peut valablement fonder l’exploitation des coordonnées publiques des DPD / DPO, diffusées en open data par la CNIL à des fins de communication sur des sujets sans lien avec leur activité professionnelle (par exemple, des messages de prospection politique).
- Fiche n°3 : information des personnes concernées. Il est impératif d’informer les personnes dont les données sont réutilisées. L’information doit être complète, compréhensible et aisément accessible et mentionner la source des données réutilisées. La CNIL rappelle également les cas dans lesquels le responsable de traitement est dispensé de délivrer l’information aux personnes concernées à savoir :
- lorsque la personne concernée a déjà obtenu les informations,
- lorsque la fourniture des informations rendrait impossible ou compromettrait gravement la réalisation des objectifs poursuivis,
- lorsque l’information se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés. Le Conseil d’Etat a jugé que l’information d‘un grand nombre de personnes (25 millions) ne suffit pas à elle seule à qualifier l’exception d’efforts disproportionnés, compte tenu du caractère intrusif du traitement et de la détention des coordonnées. Ainsi, l’extraction par une entreprise des données de profils de réseaux sociaux (photos, établissements scolaires, employeurs, etc.) pour enrichir un service d’annuaire téléphonique ne pouvait légalement intervenir sans une information individuelle préalable (arrêt du 12 mars 2014, n° 353193)
- lorsque le traitement est mis en œuvre aux fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire, ou d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste.
- Ou dans les autres cas prévus par des dispositions légales constituant une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir des objectifs d’intérêt public particulièrement importants (article 48 alinéa 4 de la Loi informatique et libertés).
- Fiche n°4 : droits des personnes sur leurs données. Les personnes concernées doivent pouvoir exercer leurs droits auprès des réutilisateurs de données. A titre d’exemple, la CNIL énonce que les courtiers en données (« data brokers ») spécialisés dans la collecte de données sur Internet, à des fins de commercialisation de celles-ci auprès d’entreprises ou de partis politiques, sont tenus de supprimer les informations se rapportant aux personnes qui en font la demande.
- Fiche n°5 : minimisation des données traitées. Seules les données adéquates pertinentes et limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des finalités poursuivies ne doivent être traitées. Lorsque cela est possible, le réutilisateur ne doit collecter parmi les données en accès libre que celles qui sont indispensables à la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas recueillir des données sensibles. Il doit procéder à leur anonymisation ou pseudonymisation lorsque cela ne compromet pas les objectifs du traitement. En cas de webscraping ou moissonnage des données, la CNIL recommande de définir, en amont de la mise en œuvre du traitement, des critères précis et pertinents de collecte, de limiter le risque de recueil de données sensibles et de supprimer toute donnée non pertinente, quel que soit son niveau de sensibilité, dès qu’elle est identifiée comme telle.
- Fiche n°6 : exactitude, sécurité et conservation limitée des données. Les diffuseurs de données peuvent procéder à a réutilisation d’une analyse d’impact (AIPD) afin de s’assurer que la réutilisation des données respecte tous les principes de protection des données. La CNIL énonce ensuite une liste des actions à mettre en œuvre afin de se conformer aux obligations d’exactitude et de sécurité des données. Elle préconise notamment de mettre en place des APIs afin d’assurer la mise à jour automatique des données depuis les sites de diffusion.
A la suite de ces fiches de principe, figurent trois fiches supplémentaires dédiées respectivement à :
- la réutilisation de données publiquement accessibles aux fins de diffusion d’annuaires de professionnels,
- la réutilisation de données publiquement accessibles à des fins de constitution ou d’enrichissement de fichiers destinés à la prospection commerciale, et
- la réutilisation de données publiquement accessibles à des fins de recherche scientifique (hors santé).
La CNIL adapte ainsi le raisonnement des fiches de principe à chacun de ces cas d’usage.
L’on peut ainsi se réjouir de la publication de ces recommandations qui permettent à chaque diffuseur et/ou réutilisateur de données de suivre pas à pas les étapes de la conformité de ces traitements.
Une question sur le RGPD et les données personnelles? N’hésitez pas à nous contacter.
- Published in blog, Données personnelles
Valeur économique et Parasitisme

Parasitisme : le simple fait de commercialiser des produits qui évoquent ceux de son concurrent n’est pas en soi fautif.
La Cour de cassation a rappelé dans un important arrêt rendu le 26 juin dernier, à l’occasion d’un contentieux qui opposait Maisons du Monde à Auchan, les conditions dans lesquelles le parasitisme peut s’appliquer.
En l’espèce, Maisons du monde reprochait à Auchan d’avoir commercialisé des tasses et des bols comportant des images de type vintage, qui évoquaient un tableau qu’elle distribuait elle-même dans ses magasins.
Pour rappel, le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre, afin de tirer indument profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
L’action en parasitisme est d’autant plus intéressante pour la victime du comportement déloyal, qu’elle ne nécessite pas de démontrer l’existence d’un risque de confusion et qu’elle est ouverte même en l’absence d’un droit de propriété intellectuelle.
Maisons du monde, considérant que les images reproduites sur les ustensiles commercialisés par Auchan évoquaient les tableaux dont elle assurait la distribution, a estimé être en droit d’engager une action en parasitisme.
Selon elle, elle n’avait qu’à démontrer l’existence d’un simple « risque d’évocation » ainsi que le détournement de ses investissements.
Dans sa décision du 26 juin 2024, la Cour de cassation lui donne cependant tort, en apportant des précisions importantes sur la notion de parasitisme.
La cour indique ainsi qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme, d’identifier la « valeur économique individualisée » qu’il invoque, ainsi que la volonté de l’auteur du parasitisme de se placer dans son sillage.
L’action en parasitisme dépend par conséquent de la capacité de la victime de démontrer qu’elle est légitime à revendiquer l’existence d’une « valeur économique individualisée ».
La Cour ne donne cependant pas d’indication permettant de préciser la nature d’une telle valeur. Par contre, elle explique de manière extrêmement pédagogique les éléments permettant d’écarter la notion de « valeur économique ».
Ainsi, elle rappelle que le savoir-faire et les efforts humains et financiers nécessaires pour caractériser l’existence d’une valeur économique, ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit.
Elle rappelle également que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre en le déclinant un concept mis en œuvre par un concurrent, ne constitue pas en soi un acte de parasitisme.
La Haute juridiction prend également soin de justifier que les juges du fond ont correctement caractérisé l’absence de valeur économique.
Elle souligne ainsi que la Cour d’appel a relevé que l’image revendiquée par Maisons du monde était disponible en droit libre sur Internet. En outre, les décors des tasses et bol commercialisés par la société Auchan, n’étaient pas des copies serviles des clichés litigieux.
Enfin, la Cour relève que la toile commercialisée par Maisons du monde l’a été sur une période limitée, que l’image n’a jamais été mise en avant comme emblématique de la collection Vintage d’Auchan, tout n’étant pas caractéristique également des produits distribués par Maisons du Monde.
La Cour souligne également que Maisons du monde ne détenait aucun droit de propriété intellectuelle sur les images litigieuses. Cette dernière précision peut d’ailleurs surprendre dans la mesure où si Maisons du Monde avait été titulaire des droits d’auteur afférents au tableau, le fondement de son action aurait été la contrefaçon et non le parasitisme.
Pour toutes ces raisons, la Cour de cassation estime que le parasitisme n’est pas caractérisé.
Cette décision est particulièrement intéressante dans la mesure où les praticiens ont longtemps considéré que le parasitisme constituait le recours ultime pour poursuivre un concurrent indélicat en l’absence de droit de propriété intellectuelle.
La Cour de cassation vient cependant rappeler que si la victime du comportement préjudiciable peut engager des poursuites en parasitisme sans avoir à se prévaloir d’un quelconque droit de propriété intellectuelle, elle doit néanmoins caractériser l’existence d’une « valeur économique individualisée ».
Nul doute que cette notion de « valeur économique » fera l’objet d’un contentieux nourri dans les années à venir.
Pour tout savoir sur les actions à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter.
- Published in blog, Propriété intellectuelle
RGPD et détective privé: l’impossible cohabitation?

Un enquêteur privé condamné pénalement pour avoir effectué, sur demande d’un employeur, des recherches sur des salariés et candidats, à partir de données librement accessibles sur internet.
L’utilisation quotidienne par des milliards d’utilisateurs, des réseaux sociaux, sites internet, et plateformes, et la publication de contenus librement accessibles, crée une manne d’informations accessibles à tous.
Dans ce contexte, nombreuses sont les personnes qui exploitent ou réutilisent ces données à des fins diverses, plus ou moins licites (preuve d’une violation d’une clause de non-concurrence, évaluation des tiers dans le cadre de la loi Sapin II, recherches de nouveaux candidats, preuve de fraude fiscale, escroquerie, etc.). Dans certains cas, elles ont recours aux services de sociétés ou de personnes spécialisées (détective privé, société d’OSINT, etc.).
Récemment, la Cour de cassation s’est prononcée sur ce sujet, à la suite d’un dépôt de plainte d’un syndicat, et plus spécifiquement sur la réutilisation de données librement accessibles en ligne par un détective privé dans le cadre d’une relation employeur/employés.
Suivant les faits repris par l’arrêt de cassation, la société était susceptible de faire procéder à des enquêtes sur ses salariés, candidats à l’embauche, clients ou prestataires. Pour ce faire, elle a fait appel aux services d’un détective privé.
Une enquête préliminaire et une information judiciaire ont été ouvertes sur les pratiques de la société. Le détective privé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de collecte déloyale de données à caractère personnel et complicité, complicité de détournement de la finalité d’un fichier, pour des faits commis « courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11 juillet 2012, en tout cas […] depuis temps non couvert par la prescription ».
Le prévenu a été condamné en première instance, puis en appel à un an d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende (Cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 27 janvier 2023).
La Cour d’appel de Versailles a estimé que :
« Le moyen de collecte de ces données est considéré comme déloyal dans les rapports employeur/employé dès lors que, issues de la capture et du recoupement d’informations diffusées sur des sites publics tels que sites web, annuaires, forums de discussion, réseaux sociaux, sites de presse régionale, comme le prévenu l’a lui-même exposé lors de ses interrogatoires, de telles données ont fait l’objet d’une utilisation sans rapport avec l’objet de leur mise en ligne et ont été recueillies à l’insu des personnes concernées, ainsi privées du droit d’opposition institué par la loi informatique et liberté ».
Celui-ci a donc formé appel de la décision et le ministère public a formé un appel incident.
L’enquêteur a violé la réglementation relative aux données personnelles
Au soutien de son pourvoi, le prévenu énonce, en premier lieu, que « ne constitue pas un traitement déloyal de données à caractère personnel le fait, pour un enquêteur privé, de recenser des informations rendues publiques par voie de presse ou des informations diffusées publiquement par une personne sur un réseau social (données en open source) » et que la Cour d’appel a violé l’article 226-18 du Code pénal.
En second lieu, il estime que les juges d’appel n’ont pas assez motivé les faits reprochés et caractérisé leur caractère déloyal.
En troisième lieu, il conteste l’étendue des faits sur lesquels la Cour d’appel s’est prononcée, eu égard à ceux figurant dans sa saisine.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur ce troisième moyen au motif que :
« L‘ordonnance du juge d’instruction ne renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel que pour les faits commis de courant 2009 jusqu’au 11 juillet 2012, la cour d’appel ne pouvait, sauf à ce que l’intéressé accepte expressément d’être jugé sur les faits antérieurs, ce qui n’a pas été le cas, considérer qu’elle était saisie des faits commis avant l’année 2009 ».
Cependant, c’est le motif de rejet du premier moyen du pourvoi qui a retenu toute notre attention.
En effet, la Cour de cassation estime que :
« Le fait que les données à caractère personnel collectées par le prévenu aient été pour partie en accès libre sur internet ne retire rien au caractère déloyal de cette collecte, dès lors qu’une telle collecte, de surcroît réalisée à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d’investigation dans leur vie privée, à l’insu de celles-ci, ne pouvait s’effectuer sans qu’elles en soient informées ».
L’on comprend ainsi que les traitements de données librement accessibles en ligne ne peuvent être réalisés que si :
- Les personnes concernées sont informées et, en conséquence, en mesure de pouvoir exercer leurs droits (notamment de s’opposer au traitement si la base légale du traitement est l’intérêt légitime)
- Les finalités de ces traitements ultérieurs sont compatibles avec les finalités initiales du traitement.
La fin des détectives privés?
Abstraction faîte des règles applicables en matière de loyauté de la preuve, cette position se comprend au regard des dispositions du RGPD relatives à l’obligation d’information des personnes faisant l’objet d’un traitement et à l’exigence d’une base légale nécessaire à sa mise en œuvre.
Néanmoins, en pratique cette décision pourrait sonner le glas de la profession de détective privé. En effet, elle implique que le détective privé informe systématiquement les personnes sur lesquelles il enquête, alors même que le secret des investigations et la discrétion sont l’essence même de sa profession.
En outre, le RGPD lui-même prévoit une exception à l’obligation d’information en cas de collecte indirecte, lorsque l’information « est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement ».
En l’espèce, le régime applicable était celui issu du Code pénal et non du RGPD. Néanmoins, la Cour suprême aurait peut-être dû s’inspirer de l’exception prévue par le règlement européen, pour tenter de dégager une solution moins radicale.
Source: Arrêt du 30 avril 2024
Filtrage, Image des enfants, Mauvaise application du RGPD: les news du mois de mai

Obligation pour les réseaux sociaux de mettre en place des mesures de filtrage des publicités illicites
Le 24 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a confirmé une ordonnance, par laquelle il a été ordonné à un réseau social de prévenir la publication de contenus litigieux en utilisant des filtres automatisés.
Cette mesure vise à protéger les droits de propriété intellectuelle de la société Barrière, en ciblant spécifiquement les publicités contrefaisantes, notamment l’utilisation sans son autorisation de la marque « Barrière » pour promouvoir une activité de jeux en ligne qu’elle estime illégale sur Facebook et Instagram. Le Président du Tribunal judiciaire de Paris a également soutenu que cette obligation de mesures provisoire n’était pas susceptible de porter atteinte à l’interdiction de soumettre un hébergeur à une obligation générale de surveillance. En effet, cette obligation de filtrage étant temporaire et limitée géographiquement au territoire de l’Union européenne, elle ne s’apparente pas à une obligation générale de surveillance.
Le réseau social a ainsi été enjoint de mettre en œuvre des mesures provisoires pour faire cesser ou prévenir toute atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
Source: Tribunal judiciaire de Paris RG n°24/02349
Le respect du droit à l’image des enfants : entrée en vigueur d’une nouvelle loi
Face à la multiplication des contenus partagés par les parents sur leurs enfants, la loi nº2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été promulguée.
Cette nouvelle réglementation vient limiter les atteintes à la vie privée des mineurs et répond notamment à plusieurs préoccupations. En effet, il est particulièrement difficile de contrôler la diffusion des images de mineurs sur internet et la diffusion de ces images peut, à long terme, leur porter préjudice.
Pour respecter le droit à l’image des enfants, la loi introduit la notion de vie privée dans l’autorité parentale, impose l’accord des deux parents pour diffuser des images de l’enfant, permet la délégation de l’autorité parentale en cas d’usage abusif et donne compétence à la CNIL pour intervenir en cas d’atteinte aux droits et libertés des mineurs.
Cette nouvelle législation marque un pas important vers la protection de la vie privée des enfants à l’ère numérique, en renforçant le cadre juridique autour de l’utilisation de leur image par les parents.
Source: Légifrance
Amende de 856 000 euros prononcée par l’Autorité de protection des données personnelles finlandaise
L’autorité de protection des données personnelles finlandaise a condamné Verkkokauppa.com Oyj à une amende de 856 000 € pour violation du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Le détaillant en ligne finlandais a en effet manqué à l’obligation de nécessité du traitement en demandant aux clients de créer un compte avant d’effectuer des achats en ligne. La société finlandaise a également été condamnée pour divers manquements relatifs aux durées de conservations des données, notamment en conservant les informations des comptes clients pour une durée indéterminée. En effet, seule la demande de suppression des données formulées par le client pouvait mettre fin à la période de conservation.
La société a ainsi été condamnée, pour l’ensemble de ses manquements à une amende, dont le montant a été calculé sur le chiffre d’affaires annuel de cette dernière, mais également à définir une période de conservation appropriée pour les données des comptes clients et corriger ses procédures exigeant que les clients créent un compte avant d’effectuer un achat en ligne.
Verkkokauppa a déclaré qu’elle ferait appel de la décision devant le Tribunal administratif.
Une question sur ces news? Consulter nos offres ou contactez-nous.
- Published in blog, Données personnelles
Violation de licence de logiciel open source : Orange condamnée pour contrefaçon de logiciel
La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 14 février 2024 nº 22/18071) a condamné Orange pour contrefaçon de logiciel à raison de la violation de la licence GNU GPL v.2.
- Rappel des faits
La société Entr’Ouvert a développé le logiciel LASSO (Liberty Alliance Single Sign On) qu’elle exploite depuis mars 2004.
Le logiciel LASSO permet la mise en place d’un système d’authentification unique, afin que l’internaute ne s’identifie qu’une seule fois pour accéder à plusieurs services ou sites en ligne, évitant ainsi d’avoir autant d’identifiants que de services en ligne.
La société Entr’Ouvert a fait le choix de diffuser le logiciel LASSO sous la licence libre GNU GPL version 2, ou sous licence commerciale en contrepartie du paiement de redevances si l’utilisation du logiciel LASSO est incompatible avec la licence GNU GPL.
En 2005, Orange a remporté un appel d’offre en vu de la conception et la réalisation d’une partie du portail « Mon Service Public » : Orange devait fournir une solution informatique de gestion d’identités et des moyens d’interface à destination des fournisseurs de services.
La plateforme logicielle dite Identité Management Plateform (« IDMP ») développée par Orange intégrait le logiciel LASSO dans sa version GNU GPL v.2 sous licence libre.
La société Entr’Ouvert, estimant que la mise à disposition du logiciel LASSO par Orange dans le cadre du projet « Mon Service Public » n’était pas conforme aux dispositions de la licence libre, a fait assigner Orange en contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme.
- Contexte : la licence libre GNU GPL version 2
La licence GNU General Public License (GPL) est l’une des licences les plus célèbres dans le domaine du logiciel libre et open source. Elle vise à permettre à l’auteur d’un logiciel de garantir la liberté de l’utiliser, le modifier et le distribuer.
Dans le cadre de ce litige, la version 2 de cette licence était applicable. Depuis le 29 juin 2007, la version 3 est communément utilisée.
Contrairement aux licences commerciales classiques qui imposent souvent des restrictions sur l’utilisation et la redistribution du logiciel, la licence GNU GPL favorise la liberté en exigeant notamment que toute distribution du logiciel sous cette licence soit accompagnée du code source et que les œuvres dérivées soient également distribuées sous licence GNU GPL.
- Contrefaçon à raison de la violation de la licence GNU GPL
3.1. La contrefaçon comme fondement
Dans le cadre de cette affaire, la Cour d’Appel de Paris (CA Paris, 19 mars 2021 2024 nº 11/07081) avait préalablement considéré qu’en fondant sa demande sur la violation de dispositions contractuelles, la société Entr’Ouvert était irrecevable à agir sur le fondement délictuel de la contrefaçon. Elle avait cependant condamné Orange au titre du parasitisme, considérant que Orange « a, sans bourse délier, utilisé le savoir-faire, le travail et les investissements de la société Entr’Ouvert ».
Mais la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt, considérant que la violation d’un contrat de licence pouvait être attaqué sur le terrain de la contrefaçon (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 octobre 2022, 21-15.386).
Reprenant la décision de la Cour de cassation et citant l’arrêt de la CJUE C-666/18 du 18 décembre 2019 IT Development c/ Free Mobile, la Cour d’appel rappelle ainsi que « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national ».
En d’autres termes, en cas d’atteinte portée à ses droits d’auteur par la violation des termes de la licence de son logiciel, le titulaire est fondé à agir en contrefaçon.
Il appartient alors au titulaire d’apporter les preuves nécessaires à une action en contrefaçon de droit d’auteur, à savoir l’originalité de son logiciel et la violation de ses droits de propriété intellectuelle.
3.2. Les actes constitutifs de la violation de la licence
En l’espèce, après avoir apporté la preuve de l’originalité de son logiciel LASSO, la société Entr’Ouvert a invoqué la violation des articles 2, 3, 4 et 10 du contrat de licence GNU GPL v.2, qu’il est possible de résumer ainsi :
- Article 2 : autorise les modifications du logiciel et la distribution de ces modifications à condition de respecter certaines exigences, notamment de munir les fichiers modifiés d’un avis de modification bien visible et que tout logiciel dérivé contenant le logiciel d’origine soit concédé comme un tout, à titre gratuit, sous licence GNU GPL ;
- Article 3 : autorise la distribution du logiciel sous forme de code objet ou exécutable à condition de l’accompagner de la distribution de l’intégralité du code source ou d’une proposition écrite de fournir le code source ;
- Article 4 : interdit de copier, modifier, concéder en sous-licence ou distribuer le logiciel sauf selon les conditions expressément prévues par la licence GNU GPL ;
- Article 10 : l’intégration du logiciel sous licence GNU GPL dans d’autres logiciels libres dont les conditions de distribution sont différentes nécessite l’autorisation de l’auteur.
Dans cette affaire, la Cour d’Appel de Paris a retenu que Orange avait bien violé ces 4 dispositions de la licence GNU GPL v.2 :
- En ayant procédé à des modifications du logiciel LASSO sur lequel est fondé IDMP et en ne concédant pas IDMP comme un tout gratuit auprès de l’Etat, Orange a violé l’article 2 de la licence ;
- En n’ayant pas communiqué le code source de LASSO alors que Orange a bien « distribué » la bibliothèque LASSO en ayant vendu, livré et transféré à l’Etat l’ouvrage IDMP fondé sur LASSO, Orange a violé l’article 3 de la licence ;
- En copiant, modifiant et distribuant LASSO sans respecter l’ensemble des conditions du contrat de licence GNU GPL, Orange a violé l’article 4 de la licence ;
- En incorporant LASSO dans la plateforme IDMP, dont les conditions de distribution sont différentes de la licence GNU GPL, et sans obtenir l’autorisation de la société Entr’Ouvert, Orange a violé l’article 10 de la licence.
Par ailleurs, l’examen du code source a permis de démontrer que la distribution d’IDMP s’est faite uniquement sous le nom de « France Telecom » alors que deux versions de LASSO ont été utilisés. La Cour d’Appel a donc également retenu une violation du droit moral de la société Entr’Ouvert.
Partant, la Cour d’Appel de paris, complétant la condamnation pour parasitisme devenue définitive, a considéré que Orange a commis des actes de contrefaçon du logiciel LASSO par violation du contrat de licence GNU GPL v2 en ses articles 2, 3, 4 et 10 et non-respect de son droit moral.
Pour exploiter le logiciel LASSO comme elle l’a fait, Orange aurait dû conclure un contrat de licence commerciale avec la société Entr’Ouvert.
- Published in blog, Nouvelles technologies
Espace numérique : que prévoit le projet de loi ?
En l’espace de plusieurs décennies, l’environnement numérique, initialement conçu comme un espace ouvert propice au progrès, au développement et au partage inconditionnel de connaissances, a fait face à la multiplication de contenus illicites et préjudiciables.
La nécessité d’une régulation plus rigoureuse de cet espace numérique s’est alors imposée.
Dans ce contexte, le 17 octobre 2023, l’Assemblée nationale a adopté, après proposition du Sénat, un projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.
Ce projet doit encore être soumis à l’examen d’une Commission Mixte Paritaire, chargée d’affiner les dispositions encore en discussion.
Parmi les multiples thématiques abordées par ce projet de loi, on peut citer la protection des citoyens dans l’environnement numérique, les Jonum ainsi que les nouveaux pouvoirs envisagés pour les autorités nationales.
Ce projet de loi témoigne ainsi d’une prise de conscience quant à la nécessité d’adapter la régulation de l’espace numérique.
- La protection des citoyens dans l’environnement numérique
Le projet de loi propose, dans son article 6, l’instauration d’un filtre de cybersécurité destiné au grand public, visant à restreindre les pratiques d’hameçonnage en ligne considérées comme constitutives d’escroquerie.
L’hameçonnage en ligne est précisément défini dans le projet de loi comme « le fait de mettre en ligne ou de diriger l’utilisateur vers une interface dont les caractéristiques sont de nature à créer une confusion avec l’interface en ligne d’un service existant et d’inciter ainsi l’utilisateur de cette interface, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à fournir des données personnelles ou à verser une somme d’argent. »
Pour atteindre cet objectif, le gouvernement prévoit la mise en place d’un système d’alerte qui sera activé lorsque les utilisateurs s’apprêtent à accéder à un site malveillant suite à la réception d’un message frauduleux.
Cette mesure vise à protéger les citoyens contre toute tentative d’accès frauduleux à leurs données personnelles ou bancaires, en recueillant les signalements des victimes dans une base de données consultable par les autorités administratives.
De surcroît, le texte renforce les sanctions pour les infractions graves en ligne telles que le cyber-harcèlement, la pédopornographie ou encore le proxénétisme.
Ainsi, de tels agissements peuvent entraîner la suspension ou le bannissement de l’auteur sur les plateformes en ligne. Les fournisseurs qui ne bloqueront pas le compte faisant l’objet d’une suspension seront également passibles d’une amende de 75 000 euros,.
L’accent est également mis sur la protection des mineurs en ligne, avec des mesures renforcées, notamment de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), pour lutter contre l’accès des enfants aux sites pornographiques.
Enfin, le projet de loi prévoit des sanctions plus sévères pour contrer la désinformation provenant de médias étrangers soumis à des sanctions européennes, notamment visées par l’article 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le projet de loi prévoit que l’ARCOM sera compétente pour mettre en demeure, dans un délai de 72 heures, les personnes, dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne et les fournisseurs de services d’hébergement, de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus provenant de médias étrangers soumis à des sanctions européennes.
En cas de non-respect de la mise en demeure, l’ARCOM pourrait ordonner le blocage du site concerné et imposer une amende pouvant atteindre 4% du chiffre d’affaires de l’opérateur.
- Les Jonum
Les Jonum, une convergence inédite entre les jeux vidéo et les jeux d’argent et de hasard, font actuellement face à un vide juridique et à une absence de régulation dans le cadre législatif français.
Dans ce contexte, et afin de pouvoir les encadrer, le projet de loi envisage dès lors d’autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les jeux à objets numériques monétisables.
Les Jonum, également désignés comme des jeux à objets numériques monétisables, consistent essentiellement en des jeux en ligne proposant l’achat d’objets numériques nécessaires à la participation et à la progression dans le jeu.
La particularité de ces objets numériques réside dans leur identification par un certificat garantissant leur authenticité, ainsi que leur monétisation, permettant leur revente sur la plateforme de l’éditeur du jeu ou sur une place de marché secondaire.
L’Assemblée nationale, lors de sa première lecture, a envisagé un nouveau cadre de régulation spécifique à ces jeux, distinct de celui régissant les jeux d’argent et de hasard, ainsi que celui des jeux vidéo.
Elle procède également à une première définition juridique des Jonum, les décrivant comme des » jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs majeurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain en monnaie ayant cours légal, sous réserve que ces objets ne puissent être cédés à titre onéreux, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle. »
Par conséquent, toute entité morale souhaitant proposer au public ce type de jeux doit obligatoirement déclarer son offre à l’Autorité nationale des jeux, conformément à l’article 15 du projet de loi.
En outre, les entreprises opérant dans le secteur des jeux à objets numériques monétisables doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le jeu excessif ou pathologique, assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu, prévenir les activités frauduleuses et criminelles, ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Enfin, un rapport rendant compte des résultats de cette expérimentation et évaluant la pertinence de sa poursuite devra être présenté au Parlement six mois avant la fin de l’expérimentation.
- Les nouveaux pouvoirs des autorités nationales
Le projet de loi vise à ajuster le cadre juridique français pour incorporer les dispositions du règlement sur les services numériques (Digital Services Act – DSA) et du règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act – DMA), deux textes européens imposant de nouvelles obligations aux grandes entreprises du secteur numérique.
En vertu du DSA, l’ARCOM est désignée comme le « coordinateur des services numériques » en France.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est chargée de surveiller le respect des obligations des fournisseurs de places de marché.
Parallèlement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) aura pour mission de vérifier la conformité des plateformes par rapport aux limitations en matière de profilage publicitaire, notamment en ce qui concerne l’interdiction pour les mineurs ou l’utilisation de données sensibles.
Concernant le DMA, l’Autorité de la concurrence et le ministère de l’Economie seront habilités à mener des enquêtes, recueillir des informations et collaborer avec la Commission européenne sur les pratiques des contrôleurs d’accès, notamment dans le cadre du « réseau européen de concurrence ».
Reste à voir si la Commission Mixte Paritaire valide les propositions de l’Assemblée nationale !
Source : Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0175_texte-adopte-seance#
nement concurrentiel équitable.
- Published in blog, Nouvelles technologies
Sony condamnée à 13 millions d’euros par l’Autorité de la concurrence : Pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des consoles de jeux vidéo
Les pratiques anticoncurrentielles persistent dans le monde des affaires, et l’Autorité de la concurrence en France demeure vigilante pour garantir un environnement concurrentiel équitable.
L’abus de position dominante, en particulier, est rigoureusement encadré pour prévenir toute distorsion de la concurrence, notamment par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mais également en droit interne à l’article L420-2 du Code de commerce.
L’Autorité de la concurrence en France joue un rôle clé en veillant au respect de la concurrence et à la compétitivité des marchés sur le territoire national mais également en sanctionnant les entreprises qui ont recours à des pratiques déloyale portant atteinte à la libre concurrence sur le marché.
Dans une décision récente du 20 décembre 2023 (décision n°23-D-14), l’Autorité de la concurrence s’est prononcée sur la conformité de pratiques dans le secteur des consoles statiques de jeux vidéo de huitième génération et des accessoires de contrôle de compatibilité avec la console PlayStation 4.
En l’espèce, la société Subsonic, un fabricant français de manettes de jeux vidéo, avait saisi en 2016 l’Autorité de la concurrence de différentes pratiques mises en œuvre par le groupe Sony.
Les services d’instructions ont relevé en 2019 des préoccupations de concurrence concernant deux pratiques pour quatre sociétés du groupe Sony, à savoir :
Le déploiement, à compter de novembre 2015, d’un dispositif de contre-mesures techniques visant à affecter le bon fonctionnement des manettes de jeux tierces que le groupe Sony présumait contrefaisantes ;
Le refus d’adhésion au programme officiel d’octroi de licences du groupe Sony pour certaines entreprises souhaitant commercialiser des manettes de jeux compatibles avec la console PlayStation 4.
En effet, Sony a conçu et commercialise depuis 2013 la console PlayStation 4, console de huitième génération, ainsi qu’une manette pour cette dernière, appelée DualShock 4, dont un exemplaire est vendu avec la console.
D’autres opérateurs commercialisent des manettes sur le marché mais le modèle conçu et commercialisé par Sony reste la manette de référence pour les utilisateurs de ladite console.
Pour qu’une pratique dite anticoncurrentielle soit caractérisée, notamment en matière d’abus de position dominante, une position dominante sur un marché pertinent doit être établie.
L’Autorité de la concurrence a retenu que le marché pertinent en l’espèce était le marché national amont de la fourniture de manettes de jeux conçues pour la console Playstation 4.
De plus, les parts de marché en France de 2015 à 2020 des manettes commercialisées par Sony et spécialement conçues pour la PlayStation 4 dépassent très largement 50 %, ce taux ne comprenant pas les manettes DualShock 4 vendues avec la console.
Ainsi, l’Autorité de la concurrence a affirmé que ce résultat est un indice très fort d’une position dominante sur ce marché, les parts de marché étant extrêmement élevées.
Rappelons que Sony est titulaire de divers brevets sur les manettes pour PlayStation 4.
Néanmoins, aucun jugement en France n’a qualifié les manettes des fabricants concurrents de contrefaçon de brevet.
De plus, les brevets sur lesquels Sony fondait des droits de propriété intellectuelle ont expiré ou étaient sur le point d’expirer.
Ainsi, les brevets, tombés dans le domaine public, ne permettaient pas de justifier d’après l’Autorité de la concurrence la mises en place des pratiques visées dans l’affaire.
En outre, certains fabricants tiers produisent des manettes pour la console PlayStation 4 licenciées par Sony dans le cadre de son programme de partenariat Official Licensed Product (ci-après « OLP »). Ce programme permet à ces fabricants d’utiliser le logo et la marque de Sony sur leurs produits, mais également de bénéficier d’un numéro unique d’identification au même titre que les manettes Sony.
Cependant, toutes les manettes concurrentes ne sont pas nécessairement licenciées par Sony, telles que les manettes fabriquées par Subsonic.
Rapidement, Sony a constaté que des manettes contrefaisantes circulaient sur le marché.
En effet, les contrefacteurs pirataient et utilisaient les clés d’identification et de cryptage des manettes contrefaites afin de cloner leur numéro d’identification unique pour les associer aux manettes contrefaisantes.
Afin de lutter contre la contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle, Sony a développé un dispositif de contre-mesures techniques permettant la déconnexion automatique et systématique des manettes ne disposant pas d’un numéro unique d’identification, ces dernières étant considérées comme contrefaisantes pour Sony.
Néanmoins, toutes les manettes ne disposant pas d’un numéro unique d’identification ne sont pas pour autant contrefaisantes. C’est notamment le cas des manettes tierces non licenciées.
Par conséquent, aussi bien les manettes de fabricants tiers non contrefaisantes que les manettes contrefaisantes se retrouvaient affectées par le dispositif technique de contre-mesures mis en œuvre par Sony et étaient ainsi déconnectées.
Il est à noter qu’il n’existe pas à ce jour d’autre possibilité pour obtenir un numéro d’identification individuel unique contrôlé par Sony et ainsi éviter les contre-mesures techniques que d’adhérer au programme de licence OLP.
Cependant, en parallèle des actions controversées de contre-mesures techniques, Sony n’offrait pas la possibilité à tout fabricant, de manière équitable, d’accéder au programme OLP, garantissant l’octroi de licences et de numéros d’identification uniques.
En effet, l’Autorité de la concurrence a souligné que les critères d’accès au programme OLP de Sony restaient opaques pour certains des fabricants intéressés, notamment Subsonic, la communication de ces derniers étant à l’appréciation discrétionnaire de Sony.
Finalement, le déploiement d’un dispositif de contre-mesures techniques en combinaison avec le refus discrétionnaire d’octroyer des licences aux fabricants de manettes tierces non licenciées, a non seulement impacté négativement l’image de marque des concurrents, mais a également freiné leur expansion sur le marché susceptible de les évincer.
En effet, les fabricants tiers non licenciés, tout comme les utilisateurs finaux, n’étaient pas avertis des déconnexions à venir mais également que l’achat de ces manettes pouvaient engendrer des déconnexions intempestives.
Par conséquent, l’Autorité de la concurrence a considéré que les pratiques mises en œuvre par Sony était largement et en tout état de cause disproportionnées permettant ainsi de les qualifier de pratiques anticoncurrentielles.
La décision de l’Autorité de la concurrence condamnant Sony pour ces pratiques opaques souligne, en outre, l’importance de la transparence dans les politiques d’octroi de licences pour assurer une concurrence équitable.
Partant, l’Autorité de la concurrence a condamné solidairement trois filiales et la société mère du groupe Sony à une amende totale de 13 527 000 euros pour des pratiques anticoncurrentielles, notamment pour abus de position dominante sur le marché de la fourniture de manettes de jeux vidéo pour consoles PlayStation 4, pendant une période de quatre ans.
Cette décision est susceptible d’appel.
Source : Décision n° 23-D-14 du 20 décembre 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs des consoles statiques de jeux vidéo de huitième génération et des accessoires de contrôle compatibles avec la console PlayStation 4
23d14.pdf (autoritedelaconcurrence.fr)
- Published in blog, Jeux vidéo
Plainte de la FTC contre Ring : Permettre aux collaborateurs d’accéder aux données des clients peut coûter cher!
La FTC a déposé une plainte contre une filiale d’Amazon pour ne pas avoir limité l’accès de ses salariés aux données personnelles de ses clients
La Federal Trade Commission (FTC) a accusé la société Ring, filiale d’Amazon, spécialisée dans la commercialisation et les services liés aux caméras de surveillance connectées, d’avoir illégalement espionné ses clients.

Le 31 mai 2023, la FTC l’agence publique américaine en charge de l’application du droit de la consommation et de la concurrence, a annoncé avoir déposé auprès de l’autorité compétente une proposition d’accord transactionnel concernant la société Ring, qui doit encore être homologuée.
L’accord prévoit notamment le paiement de 5.8 millions de dollars par Ring à ses clients.
Les manquements liés à l’accès aux données au sein de l’organisation
En l’espèce, la FTC reprochait dans une plainte à la société de ne pas avoir limité l’accès aux vidéos de ses clients, accessibles depuis les caméras connectées. Fait d’autant plus grave que la campagne publicitaire autour de ces produits était axée au tour de la sécurité apportée par la vidéo-surveillance (« protect your home » « bring protection inside ».)
Une absence totale de restriction à l’utilisation des données des utilisateurs
La FTC révèle en effet que tout employé ou prestataire de la société était autorisé à accéder aux vidéos enregistrées chez les clients. La FTC souligne que cet accès était évidemment non nécessaire et était complet, aucune mesure de restriction n’ayant été mise en place.
La plainte souligne notamment que des sous-traitants basés en Ukraine ont donc pu avoir un accès total aux vidéos enregistrées par les détenteurs de caméras Ring.
L’accès aux vidéos des clients n’était donc pas limité aux fonctions pour lesquelles il était nécessaire : le service support ou les équipes en charge de l’amélioration du produit.
A titre d’exemple, la FTC relève qu’un ingénieur en charge des réglages des projecteurs accompagnant les caméras aurait pu avoir accès si nécessaire à des vidéos d’utilisateurs installées en extérieur, mais certainement pas à celles tournées par des caméras installées dans une chambre.
Pire, aucune restriction technique n’empêchait le téléchargement, la sauvegarde ou le transfert de ces vidéos par les employés et collaborateurs de Ring. Il était même possible pour les collaborateurs de Ring de rechercher sur une base de données les vidéos enregistrées par les caméras, selon le nom donné à celles-ci. Cela a notamment permis à un employé de rechercher prioritairement des vidéos d’espaces « intimes » en utilisant le mot clé « bedroom » ou « bathroom ».
L’autorité américaine souligne que la filiale d’Amazon a échoué à mettre en place les mesures de sécurité les plus élémentaires. Cette imprudence a notamment permis à un employé de la société d’accéder à des milliers d’enregistrements de clientes dans leurs chambres ou salles de bain.
Un défaut de contrôle et de suivi de l’utilisation des données
Circonstance aggravante, une fois cette entorse à la règlementation relative au droit à la vie privée détectée, Ring a mis en place des restrictions concernant l’accès des vidéos par son personnel mais n’a pas été en mesure de garder la trace de ceux-ci et donc de déterminer s’ils étaient légitimes.
Ring même après avoir limité l’accès de son personnel à ses bases de données n’était donc aucunement en mesure de détecter une fuite ou un accès non-autorisé.
La FTC insiste sur l’absence de moyens techniques permettant de gérer les accès aux données sensibles
L’autorité ajoute dans sa plainte que Ring n’a ainsi « aucune idée » du nombre d’accès non autorisés ayant eu lieu.
La FTC indique que Ring a découvert les agissements de certains de ses collaborateurs uniquement par « chance » et qu’il est donc extrêmement probable que de nombreux incidents n’aient pas été détectés.
Ces révélations ne reposent effectivement que sur la vigilance des employés ayant rapporté à la direction ces atteintes à la vie privée, alors même qu’ils ne s’étaient pas vus confier cette mission.
La plainte relève également la légèreté d’un supérieur hiérarchique auquel un rapport avait été remonté par une employée concernant les accès à de très nombreuses vidéos par un ingénieur employé par Ring.
Le personnel de Ring ne bénéficiait d’aucune formation en lien avec les données sensibles des utilisateurs, et donc d’aucun mécanisme d’alerte ou de procédure de traitement des incidents.
Cela pourrait expliquer que les pratiques de l’entreprise se soient améliorés de manière très lente, la FTC considère que Ring a échoué à mettre en place des mesures de sécurité élémentaires de 2016 à 2020.
Enfin, la société n’a jamais clairement informé ses clients que la consultation des enregistrements par ses employés était possible, et a utilisé des termes vagues à ce sujet dans ses documents contractuels.
Les sanctions et mesures prévues par l’accord transactionnel
En supplément des mesures pécuniaires qui serviront au remboursement de clients, la FTC propose à la société Ring de mettre en place un programme de sécurité des données personnelles et de respect de la vie privée contraignant.
L’accord prévoit également la suppression de toutes les données qui étaient consultables de façon illicite, avant une certaine date et tous les travaux, notamment de développement et d’entraînement de technologie de reconnaissance faciale, associés.
La FTC souhaite ainsi clairement établir que la violation de la réglementation sur les données personnelles et la vie privée a un coût.
Source: FTC Says Ring Employees Illegally Surveilled Customers, Failed to Stop Hackers from Taking Control of Users’ Cameras
Adoption au Sénat du Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique
Le 5 juillet 2023, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi modifié visant à sécuriser et réguler l’espace numérique. Il sera présenté devant l’Assemblée nationale en septembre 2023.
Le projet de loi s’inscrit dans l’évolution rapide au niveau européen des dispositions visant à réguler les activités en ligne (avec, notamment, l’entrée en vigueur du Digitale Services Act (DSA) et du Digital Market Act (DMA)). Il intègre également certaine des recommandations formées dans les rapports sur la souveraineté numérique et la protection des mineurs face à la pornographie et aux fins de régulation des activités des influenceurs.

Les conditions de signalement de contenus illicites sont ainsi renforcées, ainsi que les obligations des éditeurs et hébergeurs en cas de saisine. Les sanctions en l’absence de traitement des notifications de contenus illicites sont également développées, conformément aux dispositions du DSA.
Le projet de loi vise également à limiter la possibilité pour les principaux acteurs du numérique de privilégier leurs propres services sur les plateformes qu’ils éditent, conformément aux principes du DMA.
Le projet de loi inclut par exemple des dispositions restreignant les frais de transfert pouvant être imposés par un hébergeur Cloud à ses clients lorsque ceux-ci souhaitent changer de fournisseur de services d’hébergement. Les frais pouvant être demandés devront se limiter aux frais de migration liés au changement de fournisseur et ne pourront donc plus atteindre les montants importants connus aujourd’hui.
Le projet de loi aborde également la question de l’absence de régulation des Jeux utilisant des Objets Numériques Monétisables (JONUM), dont le statut a fait l’objet de nombreux débats. La qualification des objets concernés, entre jeux d’argent et actifs numériques, ne semble pas encore totalement tranchée.
Le projet de loi prévoit cependant la possibilité pour le Gouvernement de prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi, les mesures nécessaires pour réguler ces jeux.
Le projet de loi constitue donc un ensemble complexe, complémentant l’intégration au droit national de plusieurs des dispositions du DSA et du DMA.
L’Arcom devrait ainsi devenir le Coordinateur des services numériques en France. Il sera accompagné dans ses missions par l’Autorité de la concurrence et la Cnil, qui devraient également être désignées comme autorités compétentes responsables de la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires et de l’exécution du DSA en France.
Source :
- Published in blog, Nouvelles technologies
Paquet numérique : ce qui vous attend !
Dire que l’on est désormais entré dans une économie basée sur la data, est devenu un lieu commun.
Avec l’arrivée de nouveaux acteurs, on assiste à l’émergence de nouvelles problématiques et à la survenance de nouveaux risques :

- le risque cyber et celui d’atteinte à la vie privée ;
- la généralisation des fake news ;
- les risques de manipulation via des commentaires mensongers ; ou encore
- la prise en compte de l’IA qui vient poser des questions qui relevaient jusque là du domaine de la science-fiction.
Le législateur européen s’est emparé de ces questions et a voté une série de textes regroupés sous l’appellation « Paquet numérique ».
Le cabinet Leben-Avocats a le plaisir de vous présenter une synthèse de ces différents textes. (Digital Service Act, Digital Governance Act, Digital Market Act, Data Act, IA Act, Cyber Resilience Act, NIS2…)
La synthèse, c’est par ici.
- Published in blog, Nouvelles technologies
Le point sur : le Digital Market Act
Par Eolia BUSATA et Henri LEBEN, avocats à la Cour
Le Digital Market Act (Règlement UE n°2022/1925 – DMA) a vocation à permettre de réguler le pouvoir des acteurs économiques en capacité de verrouiller l’accès aux marchés numériques dans l’Union européenne.
Le Règlement s’applique ainsi aux acteurs disposant de capacités de verrouillage ou de contrôle de leurs marchés, car ils constituent un point d’accès important des entreprises utilisatrices pour toucher leur clientèle, et qui sont alors qualifiés de « contrôleur d’accès » ou « gatekeepers ».
La qualification de contrôleurs d’accès sera appliquée automatiquement à toute entreprise qui, au cours des 3 dernières années, a :
• Réalisé 7,5 milliards d’euros au moins de CA annuel dans l’UE ou 75 milliards, d’euros ou plus de capitalisation boursière durant la dernière année ;
• Eté utilisée par au moins 45 millions d’utilisateurs finaux par mois et 10.000 professionnels par an ;
• Fourni un ou plusieurs services de plateforme essentiels dans au moins trois pays de l’UE, parmi lesquels : services d’intermédiation (comme les places de marché, les boutiques d’applications), moteurs de recherche, réseaux sociaux, messagerie en ligne, etc.
Une fois ces seuils atteints, les entreprises concernées devront s’identifier auprès de la Commission européenne dans le 2 mois de l’entrée en vigueur du DMA. Celle-ci étudiera alors la déclaration et procédera, si applicable, à la désignation de l’entreprise déclarante en tant que « contrôleur de marché ».
Les premières désignations sont donc attendues début septembre 2023.
La Commission pourra, dans tous les cas, désigner unilatéralement les entreprises qui remplissent les critères mais ne se signalent pas comme telles.
Par ailleurs, les entreprises dont l’activité est susceptible de les placer en position de domination de leur marché sans que cette position soit encore durable se verront attribuer le statut de « contrôleurs d’accès émergents ». Certaines des obligations applicables aux contrôleurs d’accès leur seront immédiatement applicables.
Parmi les mesures prévues par le règlement pour encadrer le pouvoir de marché des contrôleurs d’accès, beaucoup vont affecter l’organisation même des plateformes.
Les entreprises concernées devront notamment :
• Rendre également faciles l’abonnement et le désabonnement au services de plateforme essentielle qu’ils fournissent ;
• Permettre de désinstaller facilement leurs applications préinstallées (tels que des suites logicielles ou un navigateur) ;
• Rendre interopérables les fonctionnalités de base de leurs services de messagerie instantanée avec ceux de leurs concurrents ;
• Autoriser les vendeurs à promouvoir leurs offres et à conclure des contrats avec leurs clients en dehors des plateformes ;
• Donner aux vendeurs l’accès à leurs données de performance marketing ou publicitaire sur leur plateforme.
Les plateformes seront également tenues d’informer la Commission européenne de l’évolution de leur organisation, en lui notifiant notamment les acquisitions et fusions qu’elles réalisent.
Ces obligations s’accompagnent de la restriction de pratiques ayant pour objet de favoriser les services annexes proposés par les contrôleurs d’accès (auto préférence de leurs produits, installation automatique de leurs logiciels sur un appareil, exploitation des données des vendeurs sur la plateforme pour les concurrencer, obligation d’utiliser le système de paiement du contrôleur, etc.).
Une entité lésée par un contrôleur d’accès pourra s’appuyer sur la liste de ces obligations et interdictions pour demander des dommages et intérêts devant les juges nationaux. La liste prévue par le règlement pourra être complétée par la Commission, en fonction de l’évolution des pratiques des plateformes.
Les sanctions prévues portent sur des montants relativement élevés, et peuvent aller jusqu’à la mise en œuvre de mesures correctives comportementales ou structurelle par la Commission.
Pour nous contacter, c’est ici. (https://www.leben-avocats.com/contact/)
- Published in blog, Nouvelles technologies
Le point sur : le Digital Services Act
Par Eolia BUSATA et Henri LEBEN, avocats à la Cour
Le Digital Services Act (Règlement UE n°2022/2065 – DSA) a vocation à réguler les services en ligne au sein de l’Union européenne, en luttant contre les contenus illicites et en renforçant les obligations de contrôle interne des plateformes.
Le calendrier d’application du règlement est étendu, les premières mesures sont entrées en vigueur en novembre et d’autres suivront, jusqu’au 17 février 2024, date à laquelle l’ensemble des dispositions du Règlement seront applicables.
Le Règlement s’applique à tout intermédiaire ou fournisseur de services en ligne offrant ses services et produits sur le marché de l’UE, indépendamment de sa localisation géographique. Les entités concernées sont, notamment, les fournisseurs de services d’informatique en Cloud et d’accès à un Internet et la plupart des lieux d’achat et de vente en ligne (places de marché, boutiques d’application, réseaux sociaux, plateformes de voyage et d’hébergement, etc.).
Un statut particulier est conféré aux très grands opérateurs ayant un nombre mensuel moyen de destinataires actifs dans l’UE égal ou supérieur à 45 millions. Ce nombre pourra être réévalué en cas d’évolution de la population de l’Union de 5%.
Les très petites et petites entreprises (moins de 50 salariés et moins de 10 millions de CA annuel) qui n’atteignent pas 45 millions d’utilisateurs mensuels seront exemptées de certaines obligations.
Toutes les entreprises concernées devront désigner un point de contact unique (et un représentant légal pour les entités établies hors UE).
Le Règlement contient plusieurs obligations dont les principales sont :
• La lutte contre les contenus illicites : plusieurs mesures doivent être prévues dont la mise en place d’un outil permettant de signaler facilement les contenus illicites, mais également l’obligation pour les marketplaces de mieux s’informer sur leurs vendeurs (vérification de leur fiabilité, de leur identité, etc.),
Le règlement prévoit à ce titre la création du statut de « signaleurs de confiance » / « Trusted flaggers », c’est-à-dire, des entités reconnues pour leur expertise dans la détection et l’identification de contenus illicites, et leur indépendance. Elles seront désignées dans chaque Etat et leurs signalements devront être traités en priorité.
Un rapport annuel récapitulant leurs actions est à adresser au coordinateur national les ayant désignés.
• Transparence : les plateformes devront mettre en place un système interne de traitement des réclamations des utilisateurs (notamment dans les cas de suspension ou de résiliation des comptes sur les plateformes) et clarifier le fonctionnement des algorithmes utilisés pour recommander les contenus publicitaires.
Ce second point s’accompagne d’interdictions spécifiques : interdiction de la publicité ciblée à destination des mineurs, ou de celle basée sur des données sensibles, sauf consentement exprès des personnes.
Les très grandes plateformes, et les très grands moteurs de recherche, sont soumis à des obligations supplémentaires, y compris :
• La mise en place d’un système de recommandation de contenus non-fondé sur le profilage et d’un registre des publicités contenant diverses informations (qui a parrainé l’annonce, comment et pourquoi celle-ci cible tels individus…) ;
• Une obligation d’analyser annuellement les risques systémiques qu’elles créent (sur la haine et la violence en ligne, les droits fondamentaux, les processus électoraux, la santé publique…) et de prendre les mesures nécessaires pour atténuer ces risques (respect de codes de conduite, suppression des faux comptes, etc.) ;
• La réalisation d’audits annuels indépendants de réduction des risques, sous le contrôle de la Commission européenne.
Le contrôle de l’application du Règlement est confié, dans chaque Etat, à un « coordinateur des services numériques », rassemblés au niveau de l’UE dans un Comité européen des services numériques. Ces coordinateurs devront être déclarés au plus tard le 17 février 2024.
En France, cette mission est confiée à l’Arcom.
En cas de violation du règlement, les coordinateurs des services numériques et la Commission pourront prononcer des astreintes et des sanctions. Pour les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, la Commission pourra infliger des amendes pouvant aller jusqu’à 6% de leur chiffre d’affaires mondial.
En cas de violations graves et répétées au règlement, des interdictions d’activités sur le marché de l’UE pourront être prononcées.
De manière générale, le règlement a vocation à s’adapter à la taille et aux conséquences éventuelles de l’activité de l’entreprise sur le marché de l’UE.
En fonction de votre activité, une analyse au cas par cas des mesures qui vous sont applicables est donc nécessaire.
Pour faire le point avec nos équipes sur les obligations applicables à votre entreprise, c’est ici. (https://www.leben-avocats.com/contact/)
- Published in blog, Nouvelles technologies
Les œuvres générées par IA sont-elles protégeables par le droit d’auteur ?
Outre son côté passionnant, la réponse à cette question aura évidemment des conséquences économiques extrêmement importantes.
Pourra-t-on continuer à exploiter le droit d’auteur ? Des redevances devront-elles être payées ? Quelle répartition pour les œuvres créées en “partenariat” entre un humain et une Ai ?
Beaucoup de questions auxquelles le Bureau du Copyright américain a tenté de répondre, en publiant le 16 mars dernier un guide à destination des créateurs.
Pour le texte d’origine : cliquez ici (https://public-inspection.federalregister.gov/2023-05321.pdf)
Par Manon GASQUET et Henri LEBEN, avocats à la Cour
Le Copyright Office, l’autorité américaine en charge de l’enregistrement des œuvres de propriété intellectuelle, a publié le 16 mars 2023, un document précisant les conditions d’enregistrement et de protection d’œuvres composées d’éléments générés par Intelligence Artificielle (IA).
Le Copyright Office indique être conscient que de nombreuses autres questions sont soulevées par l’usage de ces technologies en matière de droit de propriété intellectuelle, tel que le sort des œuvres utilisées pour entrainer les logiciels.
Il s’attèle cependant en premier, à résoudre l’épineuse question de l’enregistrement, en tant qu’œuvres protégeables, des images, textes et sons produits par les IA dites « génératives ».
La nécessité d’un auteur humain
Le Copyright Office cite à titre d’exemple son refus d’enregistrer en tant qu’œuvre protégée A Recent Entrance to Paradise créée par une IA (« Creative Machine »), peu importe que celle-ci ait elle-même, été créée par un auteur bien réel.
En novembre 2018, le Copyright Office avait fait valoir que l’œuvre n’était pas protégeable à défaut d’avoir un auteur humain.
Cette position était d’ailleurs conforme à la jurisprudence de cette institution qui, par le passé, avait refusé de faire suite à des demandes singulières, telles que l’enregistrement d’œuvres ayant pour « auteur » un animal ou des « êtres célestes ».


Le Copyright office semblait cependant dernièrement s’être éloigné de cette jurisprudence, en autorisant l’enregistrement d’un roman graphique intitulé Zarya of the Dawn, dont l’auteure revendiquée, Kristina Kashtanova, certes humaine, s’était appuyée sur l’IA Midjourney pour réaliser les visuels de l’œuvre.
Midjourney est un générateur d’images qui permet de créer des illustrations à partir d’un texte descriptif rédigé par un utilisateur, en se basant sur l’intelligence artificielle.
Néanmoins, le Copyright Office est finalement revenu sur sa décision, estimant que l’auteure de l’œuvre pouvait uniquement revendiquer la paternité des éléments qu’elle avait effectivement créés, à savoir le texte, la composition, l’arrangement des éléments visuels et écrits, mais excluait donc les images générées par Midjourney.
Une appréciation au cas par cas
Le Copyright Office souligne toutefois la difficulté à appliquer ce critère et rappelle, que l’intervention de logiciels ou de procédés automatisés dans le processus créatif, n’est pas un phénomène nouveau.
En pratique, l’autorité indique que le bénéfice de l’enregistrement devra être décidé sur la base d’une évaluation spécifique, pour déterminer si la création est le fruit d’une intervention humaine suffisante pour être qualifiées d’œuvre protégeable.
Il est d’ailleurs rappelé que le principe même d’une IA générative, est que son utilisateur ne détient pas en principe le contrôle créatif ultime.
Pour illustrer son propos, le Copyright Office cite l’exemple d’un utilisateur d’une IA qui lui demanderait de générer « un poème sur le droit de la propriété intellectuelle à la façon de Shakespeare ».
En pratique, c’est l’IA qui déterminera le rythme du poème, les mots choisis dans les vers ainsi que la structure du texte. Une telle création n’est pas susceptible de protection.
En revanche, une modification suffisante de la création initiale de l’IA, ou un travail créatif important de la part de l’utilisateur sur la sélection ou l’arrangement de ces éléments, devrait pouvoir bénéficier d’un enregistrement auprès du Copyright Office.
Mais dans ce cas, seuls les éléments d’origine humaine seront protégés.
Recommandations du Copyright Office
Le Copyright Office donne quelques recommandations sur la manière de renseigner une demande, lorsqu’une IA est impliquée :
• L’auteur d’un texte reprenant des parties de textes générés par IA devra faire porter sa demande de protection sur les éléments créés par lui uniquement.• Une personne ayant arrangé des textes d’origine humaine et non humaine devra fonder sa demande sur son travail de sélection, coordination et d’arrangement, en décrivant précisément quels éléments ont été générés par une IA.
• Le Copyright Office invite également les personnes dont la demande est en cours d’instruction à régulariser le cas échéant leurs demandes.
Et en France ?
Il convient tout d’abord de rappeler que la position du Copyright Office est susceptible d’évoluer en fonction de la jurisprudence des tribunaux américains qui ne manquera pas d’intervenir.
En France, le droit d’auteur est automatiquement attribué au créateur d’une œuvre qui reflète sa personnalité et son investissement intellectuel. Nul besoin donc de procéder à un enregistrement pour que ce droit existe. (Attention cependant à ne pas confondre existence du droit et preuve de l’existence…)
A ce jour, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la question de l’existence d’un droit d’auteur sur une œuvre générée par l’IA.
Il est donc difficile de répondre à la question de départ.
Une position envisageable pourrait cependant être de considérer que :
- L’IA est protégeable par le droit d’auteur en tant que logiciel ;
- L’œuvre créée par l’IA constitue une œuvre dérivée du logiciel protégé.
Il s’agit bien évidemment d’une approche purement prospective, et qui générera certainement encore beaucoup de questions.
Dans tous les cas, il reste possible de solliciter une IA pour savoir comment celle-ci envisage la protection des œuvres créées par son intermédiaire…
Pour savoir comment protéger vos œuvres : c’est ici. (https://www.leben-avocats.com/contact/)
Retrouvez l’intégralité du Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence (https://public-inspection.federalregister.gov/2023-05321.pdf)
- Published in blog, Propriété intellectuelle